Deux candides égarés dans les Aurès
(La guerre d’Algérie 1958-1961)
Une autre biographie d’appelé de la guerre d’Algérie posté sur ce blog:http://alger-mexico-tunis.fr/?p=1949
Michel Drain Mothré: SOUVENIRS D’UN JEUNE FRANÇAIS: FRANCE ALGERIE (1956-1959)
[une introduction à ce texte: http://alger-mexico-tunis.fr/?p=780 donne le cadre socio-démographique du système des SAS, outil de transformation massive des campagnes algériennes de 1956 à 1961] Une note commentant le film passé sur « La 5 » en novembre 2019 est sur le site de l’association Coup de soleil http://coupdesoleil.net/blog/guerre-dalgerie-des-appeles-dimanche-3-novembre-television-la-5/
Michel Bibard
Á Jacqueline, Jean Le Meur, Patrice Luneau, Allaoua Rebaï et Mohammed ben Youssef sidi Yahia
Pour Dominique et Laurent
Pour la première fois depuis les 18 mois d’existence de ce blog, un ami accepte d’y participer par le présent récit de souvenirs. Je connaissais déjà le brouillon de son texte, qu’on peut consulter sous sa forme orale http://www.youtube.com/watch?v=80_vrxra4gw
Mon texte le plus récemment posté « Les SAS dans la guerre d’Algérie » http://alger-mexico-tunis.fr/?p=780 est en somme l’introduction d’un géographe aux souvenirs d’un homme de littérature ; en espérant qu’après Michel Bibard, d’autres me confient leurs réflexions et leurs souvenirs. Claude Bataillon
J’avais treize ans, en juillet 44, quand mon frère est allé sonner les cloches du village: c’était la Libération, les blindés Leclerc avaient fait une brève pause dans l’Yonne, nous allions voir arriver les troupes de choc américaines affamées de légumes et fruits frais, les Résistants de Saint-Julien-du-Sault paradaient en faisant pétarader leur traction-avant qui arborait un grand sigle FFI à la peinture blanche, les deux réfugiés républicains espagnols et notre ami le gendre du notaire, avec sa radio clandestine, avaient fait une belle Résistance. Nous ne rêvions que de gloire, dépités que notre jeunesse nous ait empêchés de prendre notre part aux justes combats contre le nazisme, exaltés par le Chant des Partisans de Kessel et Druon.
Au long de notre adolescence les guerres ont continué et nos sentiments ont évolué. Comme l’immense majorité du monde, qui l’a oublié vertueusement aujourd’hui, nous avons été ravis que l’horreur d’Hiroshima ait mis à genoux le Japon militariste. Puis tout est devenu ambigu, l’allié soviétique est devenu l’ennemi de l’allié américain en Corée, nous approchions de nos vingt ans, l’adolescence se révoltait contre le monde bourgeois, on pouvait « faire chier père » en prétendant être -ou presque- du Parti; LE Parti communiste, plus grand parti de France après la guerre, avec ses « martyrs de la Résistance », avec des tas de copains militants passionnés et sincères -seulement un peu trop prosélytes pour être vraiment convaincants. Mais, devant l’image d’un Staline en grand pacifiste, j’ai, comme tant d’autres étudiants, signé « l’appel de Stockholm ». Au lycée puis au Quartier Latin on commençait à parler du colonialisme et des guerres d’indépendance, qui ressemblaient fichtrement à notre Résistance et dans lesquelles le Chant des Partisans pouvait, sans détonner, être entonné par nos nouveaux ennemis.
Pourtant l’enfance et l’adolescence scolaires s’étaient enchantées des cartes du monde qui nous donnaient, hors de toute critique ou réflexion, l’orgueil géographique d’être français : des taches roses réparties sur la mappemonde entière nous montraient un empire auquel ne pouvait se mesurer que l’Empire britannique. L’immense tache rose du Sahara contrebalançait en étendue l’Inde « anglaise », peu nous souciait qu’à l’époque ce ne fût qu’un désert sous lequel seul l’apôtre ardéchois Conrad Killian avait subodoré les richesses pétrolières. Nous étions donc, par les Républiques comme par l’État français, élevés en toute bonne conscience dans un patriotisme conquérant, bienfaiteur et héroïque. Pour le reste, l’univers politique nous intéressait moins que la découverte de cette partie du monde si mystérieuse et fascinante, « les filles », et nous étions soumis au devoir de réussir nos études, dont l’ambition suprême et désespérée était de faire partie des trente-deux élus annuels à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm.
Adolescent dans la France coloniale
Mais dès 1946 il a bien fallu penser à l’Indochine, avec des résonances familiales et amicales -un de nos amis faisait ainsi chanter les filles « Si tu ne me cèdes pas, je m’engage dans les paras en Indochine! ». Nous ne savions guère qu’un Thierry d’Argenlieu préparait le désastre en trahissant les accords signés par Leclerc avec Ho Chi Minh, désastre qui serait couronné en 1954 par l’immense imbécillité stratégique de Diên Biên Phu. Nous recevions à Villevallier, dans l’Yonne, notre cousin Jean Peyrotte, durement éprouvé: nommé administrateur des colonies au Tonkin en 1940, il s’y était fait piéger par la guerre, avait été emprisonné dans un camp japonais, s’était évadé en pirogue et n’avait retrouvé six ans plus tard, à Vincelles, que les tombeaux de ses parents. Puis il y eut ses deux neveux, cousins avec lesquels nous avions partagé l’aventure de l’exode, militaires de carrière, fils d’un futur général, qui nous ont raconté l’épouvante de se battre dans la jungle contre un ennemi parfois tonitruant mais invisible, et le doute sur l’appui des populations à la politique française. Et aussi une cousine Bibard, « AFAT » à Saïgon. Plus tard le témoignage de mon beau-frère, dont l’avion s’était abattu dans les lignes « viet » … enfin Mendès-France vint…
Pris dans une histoire nationale et familiale rythmée par les guerres, nous étions tout prêts, par fidélité aux médailles de nos héros, à participer de cette gloire patriotique ; mais y avait-il à la fin des années cinquante une guerre « juste » autre part que dans la Sierra Maestra, aux côtés des Barbudos de Castro et Guevara?
Nous n’avons donc pas attendu 1954 pour que le problème algérien nous soit sensible. J’ai eu vingt ans en 1951 en pleine effervescence du Quartier latin au sujet de la décolonisation. En famille, avec la crise d’adolescence, le sujet faisait polémique, surtout depuis la mort, dès 54, de Joël Milandre, un ami des vacances campagnardes, aux commandes de son avion. Mon frère Pierre, ayant devancé l’appel, avait fait ses classes en 52 au Maroc, où il était devenu sergent avant d’être promu sous-lieutenant et envoyé en Allemagne. Il avait au Maroc été témoin d’actes de guérilla, dont la disparition corps et biens d’un camion chargé de légionnaires dans la médina de Fez. Il jugeait bien naïve la prétention des militaires français de « former » à la guerre les remarquables guerriers -par culture historique- marocains ou maghrébins en général… J’ai lu plus tard le témoignage d’Isabelle Eberhardt sur la guerre d’Algérie et du Maroc, autour de 1900, d’une fascinante ressemblance avec celle de 1954 : les mêmes « insoumis » n’avaient pas attendu un demi-siècle pour « relever la tête »!
J’insiste sur ce contexte personnel : une famille avec quelques militaires de carrière dont deux finiront généraux, un grand-oncle promu colonel à Verdun et commandeur de la Légion d’Honneur, un beau-père lieutenant-colonel de réserve, croix des deux guerres, de même que mon oncle Bibard, un grand-père héros de 14 avec sa balle enkystée au cœur comme son patriotisme, et toute une collection de médailles pour ces « guerriers pacifiques » des deux guerres mondiales (et une bisaïeule, née en 1870, au nom revanchard de Victoire !) : mon opposition à l’injuste et absurde guerre d’Algérie, malgré la crise d’adolescence, ne pouvait donc absolument pas devenir insoumission, désertion ou même rébellion. Mais le souvenir de la Résistance et l’exemple héroïque de mon beau-père Edmond Plantier, instituteur, communiste, FTP, nommé lieutenant-colonel et décoré par De Gaulle nous faisaient sentir ce que pouvait être le désir de liberté et de justice animant les « rebelles » algériens. Même du côté de nos militaires de carrière : mon cousin colonel avait été arrêté par les Allemands pour complicité avec la Résistance et son fils, militaire lui aussi, avait été déporté deux ans à Oranienburg.
S’ajoutent à cela la lecture d’Albert Camus, et les discussions passionnées avec les autres étudiants, pieds-noirs ou métropolitains, de tout bord politique, et notre intérêt qui s’est développé pour le problème algérien. A la salle Wagram en 1954, Charpentier, Baisnée et moi, seuls Européens à notre grande surprise, nous avons assisté à un meeting d’Algériens, calmes et dignes. L’un d’eux a cité ce conte kabyle : un homme et son fils se font attaquer par des ennemis et dépouiller. « Père, ils nous ont battus » dit le fils. Le père répond : « Mon fils, ils nous ont reconnus ». A la sortie, les trois étudiants un peu naïfs se font photographier par des policiers en civil : avions-nous déjà une fiche aux R.G.?J’avais à la même époque écrit un article, refusé, sur la littérature maghrébine d’expression française, où je citais Mouloud Feraoun, Mohammed Dib, Kateb Yacine, Mouloud Mammeri, Driss Chraïbi (Les Boucs), Ali Boumahdi – anachronisme de ma mémoire? – (Le Village des asphodèles) et Albert Memmi. J’ai eu aussi la velléité, une fois revenu à mes occupations d’enseignant, d’entreprendre, sous l’égide de Marie-Jeanne Durry, une thèse sur la littérature maghrébine d’expression française.
Initiation à la guerre : Jean Le Meur objecteur de conscience
Après la khagne de Louis-le-Grand, je suis resté en relation avec les meilleurs amis que j’y avais connus, dont le brillant et malicieux paysan breton Jean Le Meur -le seul parmi nous capable de réciter par cœur les Bucoliques aussi bien que de traire vaches et chèvres ! J’incarnais pour lui, comme pour quelques autres des excellents et très sages élèves de province sélectionnés dans cette khagne, le Parisien dragueur et un brin snob, qu’il ne manquait pas de charrier. Il a été appelé sous les drapeaux avant moi et j’ai suivi son aventure militaire grâce au courrier que nous échangions. Je cite chronologiquement des extraits de ses lettres, les premières me parvenant quelques mois avant mon incorporation dans le service du Matériel à Montluçon, lors de l’été le plus intense et nostalgique de ma vie:
14 juillet 1958 TABERGDA dans les Némentchas – Anniversaire de la prise de la Bastille.
Cher petit. 0n ne peut pas dire que tu sois bien causant, ou que tu aies la plume prolixe. Je te suppose absorbé par de nouvelles conquêtes, ou fasciné par une nouvelle idole. A moins que tu ne sois en Suède, ou requis par le service militaire. Je suis passé à Valence pour une permission de 10 jours. Sans avoir ou presque le temps de te faire visite. Sous lieutenant, comme il se doit, promis à une brillante carrière. Mais j’ai le malheur d’avoir des idées , et ça m’a conduit à des bêtises. Juge un peu. A ma sortie de l’école j’avais choisi une affectation dans les affaires Algériennes, la fine fleur de la pacification, cela par idéalisme et non sans naïveté, puisque j’avais encore des places en Allemagne ou en France, étant donné mon rang honorable (? 122/400) mais à notre retour de permission on nous a fait savoir (nous = une cinquantaine de couillons de mon acabit) qu’avant de diriger des chantiers de jeunesse ou des centres de formation (style Algérie française) il fallait exercer un commandement de section. Et ma foi ne restaient plus que des postes dans le Djebel, en particulier dans le Constantinois où l’armée a bien la situation en mains, comme disent les journaux. Il m’a bien fallu alors accorder mes violons. Depuis longtemps je disais avec M. Guy Mollet que cette guerre était imbécile et sans issue. Je disais aussi que les fellaghas combattaient pour une cause profondément juste et que leur révolte n’était que le refus désespéré de l’injustice. La suite allait de soi. Et pourtant j’ai essayé de trouver des échappatoires, de remettre à plus tard, d’inventer des restrictions mentales. Macache. En désespoir de cause je me suis résigné à être logique et j’ai envoyé au ministre de la défense nationale ma démission d’officier en lui disant que fallait pas compter sur moi pour faire la guerre aux fellaghas. Le colonel Marey, commandant l’école militaire de Cherchell, m’a collé 15 jours d’arrêts de rigueur. Le colonel commandant le 94° RI, où je suis affecté jusqu’à règlement de l’affaire, m’en a donné autant. Ce qui fait qu’aujourd’hui et les jours qui suivent je suis assigné à résidence dans ma chambre et que je jouis ainsi de loisirs studieux et de recueillement. Au loin on entend la fanfare de la Fête nationale que je te souhaite fraîche et joyeuse. J’aperçois d’ici un paysage sensationnel. Nous sommes à 1200 mètres d’altitude dans une vallée aux versants abrupts et dénudés, flanquée d’un cirque impressionnant d’une régularité géométrique. Le terrain est formé de couches rocheuses parallèles si bien que le cirque est un amphithéâtre où sont taillés de gradins concentriques. Une route en corniche a été aménagée sur un de ces gradins.
Le village berbère (?) est juché au sommet des pitons , et hier, lors du feu d’artifice traditionnel, on avait un spectacle impressionnant, irréel, fantasmagorique. Ça a vraiment une très grande gueule. Ce pays est aux confins du désert. Y vivent des semi-nomades aux chevaux magnifiques. On se demande par quel miracle. J’ai vu une petite caravane d’ânes et de chameaux (ou de dromadaires). Les hommes de ce pays ont une grande allure et les enfants sont d’une beauté merveilleuse.
J’aimerais beaucoup connaître ce pays – à commencer par la langue. Mais tu penses bien que je ne dois pas compter sur l’armée pour me fournir une documentation sur un pays qu’elle administre manu militari, tout en étant persuadée qu’elle fait tout « pour le bien des indigènes ». Et à certains égards il se peut que ce soit mieux que l’administration antérieure. Mais je manque d’éléments.
Le P.C. du régiment occupe la gendarmerie, édifice imposant, bien fait pour renforcer la crainte du gendarme, αρχην ςσφιας [début de la sagesse]. Je pense que les gendarmes étaient dans ce pays perdu les seuls représentants de la France. Aucun Européen n’habitait à Tabergda.
Les colonels montrent ou affectent beaucoup d’optimisme en parlant de la pacification, de l’appui des populations. Il n’y a guère de chefs de section à montrer tant de confiance. Ils font la guerre sans illusions, avec philosophie ou amertume. On se résigne progressivement à certaines méthodes. On ne peut qu’être épouvanté devant la dégradation progressive de certains esprits. Les officiers enfermés dans leur tour d’ivoire (surtout les officiers supérieurs), et dans l’optimisme officiel ne sont pas sensibles à ces faits. Et puis ce sont des gens qui aiment la pensée toute faite, qui n’aiment pas la pensée, et se contentent de ressasser les formules officielles. Et puis l’univers militaire est quelque chose de simple, de mécanique, qui ne favorise ni la réflexion, ni la subtilité et qui émousse l’imagination, le sens de l’humain, le réalisme. J’arrête là. Il y a beaucoup à dire. Je reste profondément pessimiste et crois la France bien malade. Fais-moi part de ce que tu deviens, de ce que tu penses . Moi aussi je suis menacé par la tour d’ivoire, par l’univers fermé de la solitude. J’ai besoin de tout ce qui peut me relier à la vie, au monde, à l’intelligence. J’ai besoin non de babioles, mais de l’essentiel: la rigueur du langage, la poésie.
Vale et gaude
Jean Le Meur S/Lt S.P. 86.966 AFN
[Au dos d’une photo jointe:]
Un aspect écrasé de Tabergda. En réalité la vallée de l’oued est vertigineuse. Le village est dans la boucle au deuxième plan. Le Régiment n’est pas visible. Au fond, mosquée, bordj. C’est très beau mais il paraît qu’on s’en lasse au bout de quinze ou vingt mois de service.
Kheirane. le Dimanche 10 août 1958
Cher petit. Merci de ta lettre qui ne me paraît pas d’un homme heureux […]L’amitié est là aussi bien impuissante et ses efforts maladroits. Le seul gain c’est peut-être le respect scrupuleux, religieux des êtres.
Le ministre a refusé ma démission, comme il fallait s’y attendre. On tient à me garder, à me faire travailler, sous une vigilance attentive. On m’a fait lire l’article 205 du code militaire: on punit de la détention ceux qui…etc.. A ton avis ça va comme ça, et l’honneur est sauf. L’honneur n’est pas sauf pour si peu, il est bien plus exigeant, plus fragile. Il ne se contente pas d’un coup de chapeau. Je ne suis pas disposé à céder. Car ce qui est en question ce n’est pas l’accessoire, les modalités, mais l’essentiel. Il s’agit de faire la guerre d’Algérie ou de ne pas la faire. Même planqué dans un bureau je participe à cette politique de répression, à cette guerre coloniale, dont les méthodes sont ce que disent les défaitistes qui n’arrivent pas à exagérer. Si je fais la guerre je dois être un combattant sur qui l’on peut compter, alimenter les salles de torture etc… Maintenir les Algériens dans les griffes de Massu, Sérigny, Lagaillarde. Je ne veux pas faire ce boulot. Il n’y a pas plusieurs manières de l’éviter. Ce faisant bien sûr j’échappe à un certain nombre de nobles devoirs qui peuvent survivre à l’intérieur du système: la solidarité avec les soldats, le respect de l’ennemi. Mais il fallait accepter le système. Et puis dans le domaine de la grâce, rien n’est inutile.
Pour le moment je suis une contradiction irrésolue. On m’a envoyé au 1/94 RI au sud des Aurès, pas très loin du désert. Kheirane est une palmeraie au fond d’un oued où l’eau continue vaillamment à couler. Une population prostrée habite ces climats. Les gosses se précipitent sur les croûtes de pain qu’on n’ose jeter aux poubelles de crainte des adjudants qui n’aiment pas le gaspillage. On va faire voter tout ça dans 15 jours. Ça peut sauver le referendum. Quelle escroquerie.
On voit de temps en temps sur les pistes des caravanes d’ânes, de chevaux et de dromadaires. Le djebel a beaucoup d’allure, mais sous ces climats on est vite fatigué.
Le secteur est calme, relativement. On sait que des bandes passent et rôdent. On ne fait pas de convoi sans appui aérien. Il y a une semaine l’aviation a bombardé la montagne à quelques kilomètres d’ici : un rallié avait indiqué l’emplacement d’un hôpital FLN et de dépôts divers. Quelques explosions ont paraît-il dénoncé l’existence de dépôts de munitions. Depuis le maquis est en feu. Une fumée à l’horizon, la nuit une longue lueur sur les crêtes.
Je dors dehors, sous les étoiles . Les nuits sont trop chaudes à l’intérieur. Les jours aussi du reste. De midi à cinq heures on ruisselle à ne rien faire. Les gars jouent aux boules, à la belote. Lisent des romans policiers, attendent la quille avec une patience étonnante. Certains auront passé plus de deux ans dans cette Thébaïde. Au prix de quel durcissement intérieur, de quelle amertume. Il y a une quinzaine de jours une des compagnies du bataillon a perdu 9 morts dans une embuscade. Les hommes sont effondrés, mal nourris, minés par la fatigue. Leur poste est un peu plus au sud, étouffé de chaleur, mangé de moustiques. Sans raison apparente on retarde de huit jours un convoi qui devait les approvisionner. les foyers sont vides. La bière consolatrice tarie.
Mais la bouche en cœur on parle un peu partout du moral de l’armée.
Lettres de Vitoux, d’Ivernel, reçu à l’agrégation et en instance d’uniforme lui aussi. M. encore collé, et sans doute catastrophé. Se marie prochainement.
Ma plume de stylo m’emmerde.
J’ai acheté un couteau « sensationnel » j’avais paumé l’autre après quatre ou cinq ans de bons et loyaux services. Celui-ci est plus joli, plus efféminé, un peu léger, mais d’une perfection esthétique.
Ici on pense aux routes ombreuses de Bretagne, aux randonnées en vélo, au cidre frais du cellier, au pain beurré, aux prairies vertes, à la douceur de la vie civile, aux bienfaits de la paix. Connaissance par l’absence. Le sourire des jeunes filles.
Dis-moi ce qui se passe, ce que tu deviens. Tu parles trop par allusions.
Vale et gaude Jean le Meur
Ούδεν πρός εμέ φοβετεον εκ τών άρχόντών έν τοίς μαλιςτα καλώνκάγαθων. [je n’ai rien à redouter des chefs, des gens très bien pour la plupart] (j’exagère un peu) Ne pinaille pas l’accentuation. Que n’ay-je estudié.
S/Lt CCAS S.P. 86580
On vous prépare de « bonnes » élections, avec des oui comme dans les démocraties populaires. Sauf accident. Mille bons jours à tous les copains
Initiation au service militaire ; SAS, c’est quoi ?
Mes souvenirs me reviennent par bouffées, de colère, de pitié et même parfois de nostalgie. Pour y mettre un ordre plus militaire, je recours à mon curriculum d’appelé: après deux mois de « classes » comme simple soldat, plus précisément « servant » à Montluçon, deux autres mois de peloton « sous-off » à Metz, puis, toujours dans le Service du Matériel, six mois comme Élève Officier de Réserve à Fontainebleau, dont quelques semaines à Bourges en spécialité auto-chars. Sorti Aspirant, volontaire pour les Affaires Algériennes, je suis envoyé directement en Algérie début juillet 59 pour, après un très court « stage » à Arzew, rejoindre la Section Administrative Spécialisée, la SAS de Morsott, au sud de Bône devenue depuis lors Annaba, dans les Aurès Nementcha, près de Tebessa. J’y reste jusqu’à fin décembre 1960, comme adjoint du capitaine commandant la SAS. J’en suis détaché deux fois pour commander par intérim, d’abord la SAS de Guentis, au sud-ouest de Tebessa (juillet -août 60) puis, au sud, la SAS d’El Ma el Abiod (octobre-novembre 60). Je suis « libéré » le 1er janvier 61 après quelques jours à Alger, aujourd’hui on dirait en bon français « de debriefing », puis vingt-quatre heures en mer, au bout desquelles nous avons vu la Bonne Mère nous accueillir sur le rivage de la nostalgie.
Les Sections Administratives Spécialisées étaient censées faire la transition entre l’administration « coloniale » et les nouvelles municipalités élues « comme en métropole », en les aidant à développer l’économie, l’enseignement et la santé. Elles étaient dirigées par des officiers des Affaires Algériennes, référence aux officiers des Affaires Indigènes de Lyautey au Maroc. Leur mission était donc en principe pacificatrice, mais toutes les interprétations et tous les débordements étaient possibles vu parfois leur isolement dans le « bled » et les « djebels », et faute de directives précises et cohérentes. Le chef de SAS avait comme bras armé un Maghzen (du mot turc qui nous a donné magasin et magazine, souvenirs lointains de la colonisation turque en Afrique du Nord, celle d’avant la nôtre!) , composé de supplétifs indigènes appelés moghaznis, commandés par un mokkadem lui aussi FSNA (Français de Souche Nord-Africaine) placé sous l’autorité de l’officier, de ses adjoints et sous-officiers presque tous FSE (Français de Souche Européenne). Un moghazni était donc l’équivalent d’un harki, supplétif membre d’une harka. Chaque maigre solde de ces supplétifs permettait, dans les Aurès misérables, de faire survivre de dix à vingt personnes, motivation à ne pas négliger.
Mais j’en reviens au début de l’aventure militaire. Après un très long sursis (deux ans inopinés après l’agrégation), il m’a donc fallu rejoindre un régiment du Matériel à Montluçon en 1958 à la fin d’un été remarquablement ensoleillé, du moins dans mon souvenir, où je laissais sur les plages de la Méditerranée les souvenirs enchanteurs et nostalgiques des « jolis corps dorés au soleil », pour entrer dans une spartiate communauté d’hommes. Notre jeunesse n’avait pas eu son content de plaisir -de bonheur?- entre la guerre et ses privations -le rationnement avait duré jusqu’en 48- et cette incorporation sous l’uniforme kaki. Il nous fallait renoncer au monde après ces dernières grandes vacances, pour nous plonger dans une existence au mieux indigente et ennuyeuse, au pire tragique. Réclusion quasi monastique: pour cause de référendum, toute la troupe fut d’abord consignée pendant six semaines. Nous en « prenions » pour vingt-huit mois de notre vie, et nous savions aussi qu’il nous fallait nous y préparer à la mort, pas forcément celle des autres… Jamais été finissant n’eut cette mélancolie. Nous devions dire adieu à « Philippine » comme dans le film, adieu à la « vive clarté de nos étés trop courts ». Et puis, de Baudelaire à Louis Aragon, imaginer que peut-être « Tu n’en reviendras pas, toi qui courais les filles » : ils furent plus de 23.000, ces hommes jeunes qui n’en sont pas revenus, et dix fois plus nombreux nos … compatriotes, adversaires, amis, ennemis, terroristes, résistants, patriotes, traîtres ? bref, les FSNA, Français de Souche Nord-Africaine, qui sont, eux, restés sur la terre algérienne en l’arrosant aussi, avec quelle générosité, de leur sang.
J’apportais dans la troupe, ainsi que quelques autres, un certain état d’esprit anticolonialiste qui faisait de nous, la « 56/2 A », appelés sous les drapeaux en septembre 56, de « jeunes » recrues, des « Bleus », plutôt frondeurs malgré la pression de la discipline, ou pour contourner celle-ci: quand on nous avait demandé, pendant nos classes à Montluçon, de choisir une chanson de marche pour la section, j’avais proposé Le Chant des Partisans, provocation qui fut ignorée, mais chacun savait bien quel malaise pouvaient ressentir d’anciens Résistants – ou leurs admirateurs – devant ces « tueurs, saboteurs » qui ressemblaient tant à nos maquisards d’hier. Mon cousin le colonel Triquigneaux, qui avait lui-même couru de gros risques pour faits de Résistance, était un ancien du Train et son « piston » m’a peut-être permis, malgré certaines manifestations subversives comme celle-là, de sortir aspirant des EOR de Fontainebleau. J’ai reçu de lui une lettre curieuse – que je ne m’explique toujours pas -, pour me « rassurer » en m’affirmant que j’irais bien en Algérie, alors qu’à l’époque notre ambition était d’y faire un séjour le plus court possible dans les services peu belliqueux du Matériel avant d’ aller nous prélasser dans une garnison, de préférence en Allemagne.
Je ne connaissais pas encore la possibilité de devenir « SAS », ce qui semblait concilier l’aide pacifique au peuple algérien et l’honneur militaire familial (car cela me rendait volontaire pour passer tout le reste de mon service, 18 mois au moins, en Algérie, je ne me dégonflais, ne m’embusquais, ne me planquais donc pas !). Je voulais aussi pouvoir répondre aux objections de ceux, surtout des pieds-noirs, qui me disaient: « Tu défends ces gens-là (pour eux les « bougnoules ») parce que tu ne les connais pas » : je voulais donc d’autant plus les connaître, ces gens-là ! Ma femme Jacqueline a approuvé mon choix et décidé de me rejoindre où que je sois nommé, comme institutrice : titulaire, elle n’aura aucun mal à se faire muter de l’Ardèche à Morsott, poste isolé, où son directeur était moins diplômé qu’elle.
Tous les jeunes Français de nos générations étaient par destination des soldats, au temps du service militaire obligatoire, deuxième creuset républicain après l’enseignement public, laïc et obligatoire. On pouvait donc se fondre – pour ceux qui avaient eu la chance d’échapper à la Préparation Militaire Supérieure, menant trop directement et trop vite aux EOR -, durant les « Classes », dans toutes les couches sociales du pays. Le jeune bourgeois agrégé des lettres découvrait avec une admiration naïve le très sérieux fumiste Tahon, le solide garagiste aux doigts de fée Garcin, et le champion de danse de salon Fayot, qui était loin d’en être un, malgré les quolibets de comiques troupiers que son nom lui attirait. Et aussi les paysans d’une France profonde, bien que fort proche de Paris, et les O.S. qui gagnaient plus que les agrégés, et le truculent HEC Michel de R., et un artiste de music-hall nommé Lellouche, plus deux docteurs en droit, et, en guise de ratons laveurs -pour rester dans la lourde et raciste plaisanterie de troufion- une dizaine de musulmans qui forçaient notre admiration en se lavant quotidiennement et rituellement ; alors que l’eau glaciale et la rareté des douches confinaient le tout-venant plus ou moins chrétien bien de chez nous, dont moi, dans une puanteur veule. Musulman d’origine algérienne était également Bounab, fils d’un restaurateur parisien, avec lequel nous discutions, aussi sincèrement que la surveillance militaire nous le permettait. Les « copains de régiment », race en voie de disparition.
Je me rappelle donc que nous avions des copains musulmans, surtout algériens, pendant les classes à Montluçon, mais je ne me souviens d’aucun qui ait fait les EOR ni même le peloton brigadier à Metz. Un copain très fayot et passionnément anti-communiste a été refusé aux EOR parce que son oncle était conseiller municipal communiste. En revanche M. P. s’est fait brimer pendant ses classes pour son refus de faire les EOR malgré ses brillants diplômes : il avait choisi de » se planquer » dans le nucléaire, et il assistera à ce titre à des expériences effarantes dans le Sahara (relatées dans le film Gerboise bleue ). Diplômes : mon indice d’agrégé m’a valu l’amicale considération de notre lieutenant commandant de compagnie à Montluçon. L’indice des militaires n’était pas fort élevé, ce qui rendait pour eux appréciables les primes de campagne, dont bénéficiait entre autres mon capitaine de la SAS de Morsott, qui avait » rempilé « . Des militaires qui s’accommodaient assez bien de la guerre. Je ne l’appréciais guère, c’était réciproque, mais j’ai appris plus tard qu’il avait très bien travaillé en faveur des supplétifs quand il s’était occupé du camp de réfugiés de Rivesaltes.
Mon premier contact avec l’Armée avait été le Conseil de Révision. A dix-huit ou dix-neuf ans tous les jeunes hommes, jusqu’à l’abolition du service militaire obligatoire dans les toutes dernières années du XXème siècle, passaient devant ce Conseil de révision, très pénible souvenir d’humiliation et de vulgarité. Après des examens brutaux et peu hygiéniques, nous défilions tout nus devant une rangée de gradés goguenards ou blasés, dont le médecin militaire qui nous demandait de manier notre sexe pour s’assurer que tout y était. Ayant dû subir une circoncision à la naissance, je me sentais particulièrement honteux, me croyant le seul « anormal » de ce pitoyable troupeau, ne me rendant pas compte que les juifs et les musulmans étaient ainsi stigmatisés. Plus à plaindre encore, les non circoncis auxquels on enjoignait de se décalotter.
Quand nous sortions enfin de ces lieux sordides, nous étions attendus au dehors par une mafia de mercantis agressifs qui voulaient nous faire acheter pompons, médailles et cocardes certifiant que nous étions de vrais petits mâles « bons pour le service, bons pour les filles ». Et certains de ces gamins que nous étions, esseulés, désorientés, intimidés, déjà embrigadés dans leur tête, se croyaient obligés d’acheter ces cocardes pour ressembler aux étalons promenés en ce temps-là dans nos campagnes par des machos insolents. C’était encore, en 1950, l’esprit du comique troupier de Courteline, beaucoup plus sinistre que drôle, avec des brimades telles qu’utiliser (ou faire semblant) la même languette pour tous dans l’examen ORL.
Quelque sept ans plus tard, à expiration de mon sursis, je me retrouvais donc » jeune recrue » avec tout l’échantillonnage socio-culturel des jeunes Français, la plupart bien plus jeunes que moi et que quelques rares autres sursitaires. Le copinage troupier pouvait être insupportable à certains, à cause de la promiscuité et de la vulgarité. L’internat scolaire et les équipes sportives m’avaient préparé. Je me sentais de plain-pied dans la vulgarité, que j’assume et que je récuse: les pauvres ne sont pas vulgaires, et nous étions tous pauvres avec notre solde dérisoire, nos habits de soldats, de simples soldats, soldats simplets, partageant nos petites misères et nos grasses plaisanteries. La grossièreté est une manière de pudeur, une délicatesse paradoxale, un art de vivre entre hommes sans femmes avec l’obsession de cette absence. Peut-être y avait-il au régiment quelque trace de cette homosexualité dont, par préjugé, indifférence ou naïveté, je n’ai jamais pris vraiment conscience dans ces attroupements d’hommes. A l’époque, le tabou était insurmontable.
Veules délices d’une totale déresponsabilisation, notre liberté aliénée aux règlements: s’habiller, manger, s’activer, dormir, tout nous était dicté selon les règles de la discipline que nous aboyaient les brigadiers. Il était jouissif de subvertir cet ordre en faisant l’imbécile (« le zouave » comme m’a fait l’honneur de me le reprocher un capitaine). On était parfois malheureux comme un pauvre rat : le froid, les capotes ou treillis qui ne séchaient pas, les souliers de pointure hasardeuse, la boue, l’insomnie sur des lits trop mous, les brimades, la trop longue séparation avec ceux et celles que nous avions laissés derrière la grille de la caserne. Par brimade envers un « prof », des sous-officiers m’avaient donné la corvée de nettoyer leur chambre ; imprudents, ils m’ont mis par là en position de les engueuler, à l’instar d’une femme de ménage consciencieuse : » Comment vous pouvez vivre dans une porcherie pareille ! ». Ils ont fini par me supplier de partir. C’était tricher un peu facilement : sursitaire indûment prolongé, j’avais cinq ou six ans de plus que ces jeunes « maréchaux des logis ».
Je haïssais la diane, cette sonnerie du réveil qui nous jetait, abrutis, dans la précipitation des ordres à exécuter « sans hésitation ni murmure ». Mais les sonneries au drapeau nous requinquaient un peu, et j’adorais celle du soir, dont tel ou tel clairon inspiré faisait, decrescendo, voluptueusement traîner les notes apaisantes.
Et il y avait la sonnerie aux morts. Ces purs éclats de cuivre, tragiques et déchirants, faisaient irruption dans nos corvées abrutissantes, nos petits conforts crasseux et minables – les cigarettes de troupe, le quart de rouge réglementaire, nos plaisanteries ou confidences obscènes de jeunes mâles obsédés malgré le bromure administré, disait-on, dans la soupe – et nous frémissions à cet appel, à ce rappel de la destinée humaine. Celle que nous nous préparions à affronter bientôt en Algérie. Cette sonnerie faisait passer un frisson de grandeur métaphysique sur notre médiocrité, en nous rappelant que nous étions là pour nous préparer à jouer avec la vie et la mort. Esprit de corps (quelle expression !) : habitués aux notes viriles du clairon d’infanterie, nous considérions comme un peu efféminée la virtuosité des trompettes de cavalerie, tout comme nous étions, bêtement, comme des animaux, prêts à nous tabasser, dans les tavernes de Metz, avec tout soldat portant un uniforme différent du nôtre, pour de misérables histoires de « filles à soldats ! », comme nous n’avions pas honte de les appeler !
On a du mal à estimer, avec la distance, ce que pouvait être la pression morale et disciplinaire, physique aussi, de l’armée sur les appelés du contingent, et même les militaires de carrière. La situation, du fait de son ambiguïté politique jamais résolue, était très tendue en Algérie. l’Armée avait, après de lourds sacrifices, perdu l’Indochine et voulait sa revanche, la République flageolait (on allait voter pour De Gaulle en octobre 58) . Se sentant incompris, les militaires renchérissaient de prétention et de rigorisme et trouvaient là l’opportunité de mater toute la jeunesse française pendant ces dix-huit, vingt-huit ou trente-deux mois où ils la tenaient à leur merci. En outre, ils étaient sûrs d’avoir compris la guerre coloniale et appris la recette pour gagner la dernière, puisque De Gaulle et Mendès-France les avaient privés de glorieux champs de bataille en Afrique Noire et en Tunisie. Mais les soldats musulmans de notre armée – dont l’adjudant-chef Ben Bella – avaient, de leur côté, encore mieux compris en Indochine les leçons des guerres coloniales ! Toute cette pression ne laissait qu’une place très réduite au libre arbitre, aux sentiments humains ou même à la réflexion chez les bidasses que nous étions, gradés ou non.
Retour à Jean Le Meur, initiation au Sud
Tabergda, le 15 octobre [1958] S.P.86-966
Cher petit. Je ne suis pas des plus empressés à répondre. Il me semble aussi que ta lettre, qui date de plus d’un mois, ne répond pas à celle que je t’envoyais vers la mi-août. De sorte que nous échangeons plutôt des monologues. Tes réactions devant l’armée ne m’étonnent pas et… me flattent, car il y a un an je les éprouvais mot pour mot […]
Les militaires, de part et d’autre de la mer intérieure, peuvent se réjouir des résultats du referendum. L’Algérie a été jalousement préservée des mauvaises lectures. Le Monde n’arrive plus, et ça me manque bougrement. Une faveur, ou une inadvertance -bénigne- La Nef de septembre. Je n’avais pas vu de journal ou publication défaitiste depuis longtemps (sauf sous pli cacheté)
Que je te raconte mes conneries. Mi août . Récidive. 5 septembre. Début d’un séjour d’un mois à Khenchela, chez les gendarmes mobiles. 20 septembre. J’apprends que je suis inculpé de refus d’obéissance et de « participation à une entreprise de démoralisation de l’armée ». C’est qu’un jour pendant une opération j’avais manifesté mon désaccord avec un commandant, de RTA, je crois qui disait et répétait sur le réseau radio: je ne veux pas de prisonniers ». Depuis trois ou quatre jours je suis de retour à Tebergda, le PC du 94° RI. Je vis comme un ermite dans ma piaule. Je viens de purger 40 jours d’arrêts de forteresse (sifflement admiratif) Ce sont des arrêts qui en principe sont plus rigoureux que les autres. Je les ai passés sans savoir que c’en étaient. J’aurai bientôt apuré mon compte de peines disciplinaires. Viendra ensuite la ration des tribunaux, et je ne suis pas encore quitte. Je m’entraîne à la philosophie, à la solitude. Je ne suis pas assez courageux pour utiliser à plein mes loisirs. Mes fréquents déménagements ne m’encouragent pas à alourdir mes bagages d’une lourde bibliothèque. Je lis le vieux Péguy qui me refile sa bonhomie, ses exigences et son intransigeance. Je me décontracte au théâtre de Musset et de Marivaux, ou j’affine mon langage en bénissant les éditions de la Pléiade.
J’écris à mes amis (sauf à toi..) Plusieurs d’entre eux s’apprêtent à entrer comme toi dans les ordres et contre-ordres. Comme Prévost, Philip, Ivernel. Vitoux est à Douai. Le grand Charles et les Marseillaises ne suffisent pas à lui remonter le moral. Braunstein se prépare à préparer l’agrégation. M. a échoué une deuxième fois et vient de se marier. Ma frangine de France et celle d’Afrique, qui est en vacances ont chacune un bébé, le plus beau du monde. Gaby travaille sa ferme et les parents vieillissent tout doucement. Je ne pense pas les revoir de sitôt.
J’étais trop compromis avec mes idées pour faire autrement. L’autre solution n’est pas plus facile, si elle est possible à tenir. (je bafouille)
L’ennui, c’est l’isolement, le fait qu’on se coupe des gars, qu’on est un faux frère qui s’en va en suisse courir l’aventure ou se planquer. Je suis pressé d’être enfin en taule où j’aurai des compagnons de misère et où je retrouverai les bonnes blagues de l’internat et de la vie de caserne.
A Khenchela, un soir pendant plus d’une heure j’ai entendu les hurlements des prisonniers qu’on interrogeait. La nuit était calme et semée d’étoiles. Les gosses dormaient (?) dans les maisons, de l’autre côté de la rue. J’ai encore fait du mauvais esprit. On m’a dit que je faisais le jeu des communistes. Un des spécialistes quelques jours plus tard s’indignait de voir les « bougnoules » maltraiter leurs bourricots.
J’ai peur de l’issue de tout ça. Je ne sais absolument pas ce qui se passe en France, s’il se passe quelque chose. Je suppose que Soustelle ne perd pas son temps. Malraux met une sourdine à son incroyable phraséologie. Il doit lui tarder de retrouver les statues qui ne s’avisent pas de contredire. Incroyable pantalonnade! Cependant les « écrivains », dans le Figaro littéraire (on lit ce qu’on trouve) vocalisent avec des trémolos « La France s’est retrouvée. Ya bon banania » Ne deviens pas trop misogyne. Tu m’écris des lettres cavalières d’aviateur. Je suis un piètre fantassin et j’aimerais mieux savoir ce que tu deviens.
Vale et gaude Jean le Meur S.P.86-966 (ou par la maison)
Tabergda le 31 octobre 58
Mon cher petit. Je suis heureux de voir que la chose militaire reste pour toi une bagatelle sportive un peu longuette, que l’on maintient en laisse et à la portion congrue. Je n’avais du reste aucune inquiétude. J’en ai par exemple pour Michel Philip qui va ces jours-ci prendre contact avec la discipline et mille autres choses qui ne sont pas de son monde. Pour Ivernel je ne crains rien. Sans du reste porter de jugement de valeur, une des grandes forces au service c’est de pouvoir sympathiser au niveau même de la vulgarité et d’avoir de la gaîté à revendre. Ça me fait penser avec émotion au bon temps que j’ai passé à Granville, et même à Cherchell. Ça n’est pas trop difficile d’être officier, tu n’as pas à te casser la tête. Cependant il y a paraît-il des écoles d’officiers où c’est le règne du fayotage, et qui laissent de moins bons souvenirs. Dans notre section je pense sans humilité que si la solidarité dans les interro écrites régnait, ainsi qu’un manque de rivalité jalouse, j’y étais pour quelque chose. Une fois officier on perd beaucoup de ces joies où le plus grand nombre était associé. Ce qu’on gagne n’est pas négligeable. Mais il y a quand même de quoi hésiter.
J’ai mieux aimé ta dernière lettre plus nourrie et plus directe que les autres. Dans mon aventure solitaire j’ai besoin de mes amis sans écran sans énigmes et sans allusion. Sinon je vais complètement me dessécher, me confondre avec mon personnage.
Je suis toujours à Tabergda, dans une chambre du sous-sol, dont le soupirail haut perché d’un demi-mètre carré me laisse voir aujourd’hui une tranche de ciel bleu. Je reçois des bouquins d’un peu partout, et n’était ma paresse, il ne tiendrait qu’à moi d’être studieux. Je le suis parfois, par distraction. Quoi que tu en dises, je pense mériter une punition. On ne refuse pas d’obéir sans encourir des risques: sinon le fondement même de la discipline est ruiné. Je suis passible de détention pour une durée que j’ignore, et qui ne peut être inférieure à deux ans. Pour ce qui est de la démoralisation de l’armée, la simple lecture du règlement ferait litière de cette infâme plaisanterie. Le drame c’est que depuis longtemps on fait litière du règlement. Je te remercie de l’appui que tu m’offres. Mais je veux jouer le jeu sans faux fuyant. Je te tiendrai au courant, (mais je compte aussi que tu m’écriras). Je pense, avant le piston, que je n’écarte pas, faire appel aux organisations qui défendent la même cause, et à la presse, si on me fait un déni de justice. Cette histoire a une signification politique que je veux préserver.
Voilà où j’en suis, ermite et anachorète contraint et forcé (par qui?) épris de communauté et bramant sa solitude sans cacher sa fierté. Malgré les instructions du bon général, la presse de gauche est toujours non grata. Le Monde n’est pas arrivé 10 fois à Khenchela depuis le 20 septembre. De Gaulle plagie Lacoste et Mollet et s’étonne de n’avoir pas plus de succès qu’eux. Je suis loin d’être optimiste. La rébellion n’est pas une frasque de jeunes gens qui jettent leur gourme. Il ne suffit pas de jouer au père de l’enfant prodigue.
Dieu te garde, et tes amours
Yours Jean le Meur S.P.86-966
Servant, c’est donc dans les blindés ? Je te croyais aviateur! (et c’est officier!)
Tabergda le 27 novembre 1958
Ainsi donc tu te maries, mon petit mimi : et c’est toi qui me donnais des conseils de prudence… « Le père de famille, le seul aventurier moderne », comme le dit mon vieil ami Péguy, dans nos fréquentes entretiens.. Envoie-moi sivousplaît, une photo de Jacqueline (je te la renverrai) que je voie le visage qui t’a sorti du « don juanisme »pour lequel tu gardais une sorte de tendresse inavouable pendant l’été. Je te souhaite très heureux et me fais une joie (pour plus tard) de faire le fou avec tes enfants. Je crains d’être un individu peu recommandable. Pour l’instant je ne vois aucune issue viable hors du célibat.
Mais, cornes d’Ubu, tu pourrais être un peu moins discret, et ne pas laisser de doubles interlignes dans tes lettres de quatrième vitesse. Tu te figures sans doute que je vais m’étaler en petits caractères sur tout ce papier, parce que tu viens de me dire : « La soupe est bonne, le temps est froid ». Un peu de pudeur.
Le 12 décembre. Je t’ai laissé longtemps en plan. Des maux de dents m’ont mis H.S. et je reviens de Khenchela où les choses se sont arrangées. J’ai regagné ma « cellule » avec soulagement. A Khenchela j’avais toute liberté de manœuvre. Mais c’est trop illusoire et trop creux pour donner satisfaction. Je suis tout de suite un étranger qui n’a pas la même histoire, le mêmes soucis que les autres, un type qui ne parle pas la langue. C’en devient même affolant et l’on préfère à tout les plaisirs de la vie recluse, et l’on maudit les lenteurs de la procédure.
Un changement important est intervenu dans mon histoire. Je ne suis plus inculpé de « participation à une entreprise de démoralisation de l’armée » . Il y a eu non lieu. Je n’ai d’ailleurs eu aucune notification officielle, et j’en suis réduit à supposer que le tribunal militaire n’a pas voulu prendre sous son bonnet une pareille accusation. J’aurai donc uniquement à répondre de refus d’obéissance. J’ai demandé à Esprit de me trouver un avocat.
Comme tu le dis j’aurais sans doute meilleur jeu sur le plan moral que politique. Mais c’est d’abord pour moi une attitude politique, la conséquence logique de certains a priori. Le problème moral est secondaire – au moins chronologiquement. Il ne suffirait pas de rendre cette guerre correcte et hygiénique pour me la faire accepter. C’est pour ça que au risque de perdre certains atouts, je resterai sur le plan politique. Au fait il n’est pas sûr que l’affaire soit jugée au fond. Ces questions dépassent la compétence du tribunal militaire qui pourrait se contenter de sanctionner un délit en quelque sorte matériel sans en tirer la philosophie.
Tu es bien gentil de me proposer ton soutien mais je ne vois pas en quoi on peut agir utilement pour moi. Somme toute l’affaire se déroule normalement et je dois pour l’instant faire confiance à la légalité. Je n’ai nullement l’intention d’esquiver les conséquences de mon intransigeance. Il est normal que l’on punisse qui refuse d’obéir, sous peine de ruiner la discipline, déjà bien chancelante, la pauvre, pour avoir reçu de nombreux coups d’en haut.
Pour l’instant je préfère que tu te contentes de « suivre ». Il faut un peu voir venir. L’évolution politique de la « patrie de la liberté » ne se fera pas sans à-coups, ni sans orage, et à ce moment-là , peut-être te supplierai-je.
Que viens-tu faire en Algérie? voir? On ne voit que ce qu’on fait, et il faut le faire pour avoir le droit de voir. Dieu te garde, mon ami.
Suis bien content de voir que tu maintiens cette haute liesse que les yeux me piquent d’y penser (syntaxe!) Comme je regrette que nous n’ayons pas vécu ensemble cette décontraction, cette insouciance qui est le plus beau fleuron de la vie militaire. J’ai conscience, jusqu’à la fin des EOR de n’avoir pas été un rabat-joie, bien que souvent les gars manquent de vis comica, de fantaisie. Et puis le canular a peu d’adeptes, c’est un art difficile. Qu’est-ce que c’est qu’un MDL ?
Je n’ai pas été trop sensible au caractère fayot des EOR, qui était pourtant réel. Dans notre section nous avions assez bien éliminé le virus, et pour ma part je m’écartais des discussions où l’on parlait boulot. Et puis je n’étais pas un concurrent sérieux je t’ai dit que tout le monde, ou presque, a été étonné de me voir sous-bitte. (pas moi, qui misais sur ma « facilité » (le fat) et sur ma chance)
Je regrette amèrement ce temps où j’avais des copains dans tous les azimuts et des occasions de rire à tous les points de la manœuvre.
Ainsi donc, après Metz, Fontainebleau, et des perm à gogo, je suppose. Dans combien de temps aurais-tu terminé ta formation?
Je te souhaite mille prospérités, mon cher petit et de la joie à revendre et des amours comblées.
Yours Jean
S.P.86.966
[MDL : maréchal des logis, sergent dans les autres armes]
[carte postale] Ta lettre du 13 décembre m’arrive aujourd’hui 23 à Biskra où l’on m’a transféré pour 60 jours d’arrêts de forteresse. Climat agréable, régime supportable et hurlements des suppliciés sont le cadre de ma nouvelle vie. On n’a guère l’esprit à se prélasser. L’horreur veille et tient éveillé – entretient la honte et la peur. Je n’ai pas l’impression d’être absurde. Ce n’est pas une consolation. (ne crois pas que je te rembarre. je te reproche seulement une fois de plus d’écrire trop rapidement, de trop laisser à deviner). Je n’ai pas à te rassurer sur ton « imprudence » je n’attache pas trop d’importance au pedigree, ni au compte en banque. Je n’aime pas à dire de mes amis qu’ils ont épousé une grosse fortune ou un arbre généalogique. J’aime beaucoup mieux penser que si je viens les voir je serai de plain-pied chez eux. Parle -moi plus longuement de ton boulot d’action ψ et de ton avenir militaire. Pour moi, rien de nouveau. Je suis toujours promis au tribunal militaire. Mais le pôvre a du travail par-dessus la tête -et je suis un mince gibier. Je te souhaite du bonheur à ne savoir qu’en faire. J’en grignoterai des miettes. Valete et gaudete
Jean le Meur S.P.86.324 (CCS. 24°RIC)
Les E.O.R. à Fontainebleau, Jean Le Meur incarcéré
Nous avons découvert une conception et un enseignement très dogmatique de la guerre de guérilla, ou de contre-guérilla. Aux EOR (Élèves Officiers de Réserve) de Fontainebleau, service du Matériel, me revint un jour d’assumer le rôle du chef des » rebelles « , chargé de tendre une embuscade aux forces de l’ordre. Chaque parti était accompagné et conseillé par un officier instructeur. La lecture de la carte m’a montré que sur le trajet choisi un seul endroit offrait les conditions idéales, selon les manuels, pour dresser l’embuscade. En rabrouant un peu sèchement sans doute mon officier instructeur, j’ai pris la responsabilité de monter l’embuscade un peu avant l’endroit où devaient évidemment l’attendre mes adversaires, malgré des positions de repli moins favorables pour nous. Les » forces de l’ordre « , surprises parce qu’elles s’en étaient tenues à la lettre des manuels, furent anéanties, ce que reconnut immédiatement l’EOR responsable. Je fus donc stupéfait de me voir engueulé et mal noté, parce que je n’avais pas joué selon les règles, en privant les officiers instructeurs de la démonstration magistrale convenue entre eux. J’ai voulu dire que dans les djebels ce n’était pas un jeu, que les fellaghas ne connaissaient ou ne suivaient peut-être pas nos règlements militaires : menacé de sanctions, craignant de ne pas être reçu officier, j’ai eu la couardise de me taire.
Mais je veux croire que cette petite démonstration de guérilla, naturelle pour tout gosse qui un jour a joué à la guerre dans la campagne, a été instructive pour mes camarades, malgré la lâcheté qu’ils partagèrent avec moi : si la réprimande à mon égard leur paraissait injuste, il s’agissait d’un concours, et ces élèves de grandes écoles – pour la plupart – ne pouvaient être mécontents de la mésaventure d’un concurrent. Cela s’appelait fayoter, et un meilleur rang de sortie vous faisait sous-lieutenant plutôt qu’aspirant sous-payé, et vous permettait de choisir un lieu d’affectation plus ou moins confortable : dans la note finale la « cote d’amour » jouait et on avait tort de vexer un officier instructeur. Mais qui sait si mes jeux enfantins de gendarmes et de voleurs, de cow-boys et d’Indiens ne m’ont pas permis de déjouer ou d’éviter une éventuelle embuscade dans le reg des Aurès : précautions ou chance, je ne crois pas avoir souvent exposé ma vie ni celle de mes moghaznis – sans doute aussi grâce à leur talent de guerriers – pendant mon séjour en Algérie. A Guentis, j’avais spontanément décidé que dans le GMC les soldats devaient être assis au milieu, face aux bas-côtés, et non, comme dans un transport ordinaire, dos au paysage. J’ai lu quelque part que je n’avais pas été le seul à prendre cette mesure de simple bon sens, plus efficace pour répliquer aux tirs en cas d’embuscade !
Il y avait aussi, même aux EOR, une certaine insouciance, une gaminerie, de ces jeunes gens déresponsabilisés par le service militaire. Lors de notre « embuscade », mon meilleur copain, au lieu d’obéir à mon ordre de repli, s’était excité en continuant à tirer des rafales de balles en bois avec son fusil-mitrailleur, et à faire de notre victoire écrasante une occasion de joyeux chahut ; comme lorsque, en treillis de combat, le visage noirci, casqués, nos chargeurs remplis de balles à blanc, nous nous amusions à effrayer, en espérant les séduire, les cheftaines qui, à la tête de leurs louveteaux, partageaient avec nous au printemps la merveilleuse forêt de Fontainebleau. Nous avons eu le bonheur de la fréquenter du 1er janvier à fin juin, dans un crescendo de soleil et de feuillages. Qui sait si cette rencontre de l’amour et de la guerre ne nous excitait pas : l’idée de la mort comme piment au goût de la vie, nous jouions aux héros tragiques du » chant des Africains » : » Battez tambours / A nos amours / Pour la patrie, pour le pays / Mourir bien loin / C’est nous les Africains … » Aujourd’hui ce chant, qu’on entend encore dans les commémorations, a été subtilement corrigé: au lieu de » Nous venons des colonies pour défendr’le pays « , » Nous venons de nos pays pour défendr’la patrie » …
Notre école d’E.O.R. était dirigée par un capitaine justement surnommé » l’Africain « , parce que le bruit courait qu’il avait réussi à ne jamais mettre les pieds en Algérie (d’où sa conception toute scolaire des embuscades ?). Mes copains proches avaient de l’humour et une certaine distance par rapport à l’institution, du fait de notre niveau d’étude, donc de notre sursis, qui faisait de nous des militaires plus âgés que les autres, de trois jusqu’à sept ans : un peu moins malléables ? Mais je me rappelle, pendant mes » classes « , un très jeune fumiste (chauffagiste, très sérieux dans son boulot) qui avait, lui, une vraie nature d’anarchiste, belle et rebelle. Nous, les vieux étudiants, nous tenions à obtenir, pour bien des raisons, parfois contradictoires, ce grade d’officier.
J’aimais cette subversion légère, lorsque je montais la garde, de » rendre les honneurs » à la plus belle femme de Fontainebleau : cette Flore digne du Titien était couturière ou secrétaire dans notre caserne, mariée à un sergent-chef, et ses formes harmonieuses et opulentes, son beau visage, auraient fait rêver des foules de jeunes hommes moins frustrés que des militaires comme nous, condamnés à l’abstinence. J’ai eu la chance de la voir apparaître un matin où je faisais la sentinelle à la porte de la caserne. Aussi impassible qu’un garde anglais, je la saluai en lui présentant les armes comme à un officier supérieur. Elle m’en a récompensé par un sourire que j’ai savouré du coin de l’œil. Salvatrice insouciance: de l’autre côté de la Méditerranée mon ami Jean est en prison.
[sous le cachet CENSURE PRISON MILITAIRE] Constantine le 29 janvier 1959 S.P.86.147
Mon cher petit. J’ai encore changé d’adresse. Je suis maintenant à l’enseigne de la prison militaire de Constantine. C’est des verrous, des grosses clés, des guichets, des judas, des barreaux trop serrés pour qu’on puisse passer entre, des murs trop hauts pour escalader. Mais quoi, j’ai connu des internats qui n’étaient pas plus libres ni mieux nourris – ni plus confortables. Il est vrai qu’à l’époque je n’avais aucun terme de comparaison. Mais aujourd’hui je sais en revanche que tout cet appareil ne peut rien contre la vraie liberté. Les techniques d’A.P. dont tu vas devenir un expert seraient-elles plus efficaces? Ne t’imagine donc pas une détention très sévère, un régime de bagnard. Je me fais plutôt l’effet d’un cistercien, d’un bénédictin dans sa cellule, dans un recueillement favorable aux élucubrations, aux spéculations. J’ai assez de bouquins pour travailler, pas toujours assez de courage.
Je suis prévenu de refus d’obéissance. Ça me coûtera au bas mot deux ans de prison, mais il n’est pas exclu que l’on cherche à forcer la dose en faveur de mes galons. Pour l’instant je me soucie assez peu de tout ça. L’instruction devrait commencer sans tarder. Le procès sera sans doute un baroud d’honneur, car le tribunal ne voudra pas (le pourrait-il ?) entendre l’affaire au fond. On jugera au nom de la discipline, ce qui est logique et insuffisant.
Je suis bien attristé de ce que tu m’écris de tes ennuis familiaux […] Il faut aussi que tu me donnes dès que tu la sauras ton adresse civile de manière que je connaisse ton port d’attache. Je ne veux pas te perdre de vue, ni que du courrier s’égare à courir sur les mers, ou de P.C. en djebel au gré de tes vagabondages.
Mais tu as l’art d’écrire au grand galop sans te soucier de répondre aux questions que naïvement je te pose. Je m’aperçois que tu as quitté ce que tu appelais ta « planque au pool d’A.P. » et que tu brigues le galon de sous-bitte. Ce n’est pas une ambition exagérée. J’aimerais quand même savoir comment se dessine ton avenir immédiat. J’aimerais aussi savoir la date de ton mariage, qui se passera dans une sorte de dépouillement, de nudité, qui m’agrée beaucoup, en dépit des absences qui pourront vous désoler. J’aimerais donc ce jour-là être avec vous, et prier pour vous. Tu comprends bien qu’ici je me sens plus que jamais attaché à mes amis, et dépendant d’eux. Je leur donnerais volontiers procuration pour être heureux à ma place: provisoirement, car je suis loin d’avoir baissé les bras. Simplement je fais retraite.
Le contact avec la prison n’a pas été trop dur car il était préparé par plusieurs mois d’arrêts, et une liberté spatiale déjà rétrécie – et puis je savais bien qu’un jour m’accueillerait cet asile. Je me souviens même qu’en juillet dernier je passais avec des copains devant ces murs et que l’un d’eux me dit: « C’est peut-être ton futur domicile ». C’était plutôt de la logique que de la prophétie. On sent au-delà des murs s’agiter une population partagée et exaspérée qui désormais a l’habitude de scruter les décisions politiques et qui se sent concernée parce que son sort est en suspens. Le gaullisme a beaucoup baissé, semble-t-il. Il n’y a pas de quoi s’étonner. Mais on peut s’inquiéter devant cet état d’esprit que rien ne prépare à la conciliation. Un des gros ennuis de la prison c’est d’être coupé des sources d’information: les publications d’ordre politique n’ont pas accès ici. N’arrivent que des échos déformés qui ne suffisent pas à reconstituer la symphonie ou la cacophonie. Ce serait sans doute instructif de pouvoir observer et débrouiller tout cela. Tu ne dois guère non plus en avoir le loisir. Je te souhaite dans la joie et forme pour vous deux les vœux les plus fervents.
Yours Jean
Ivernel aux Allemagnes, puis aux Afriques ? Nicht EOR. Eczéma. Ne m’écrit pas depuis 100 jours. M’inquiète et surtout inquiète ses parents. A la grâce de Dieu.
[A.P. : bureau d’Action Psychologique] [sous le cachet CENSURE PRISON MILITAIRE] Samedi 14 mars 1959. Constantine.
Mon cher petit, te voilà donc marié et multiplié par deux . Je voudrais te souhaiter un bonheur exigeant et insolent, la joie de vivre, et l’espérance plus forte que les ennuis. Ce ne sont que des banalités, et je te vois partir en guerre contre les mots simples […] Je suis étonné de te découvrir scrupuleux, je veux dire un peu incertain, et pas trop présomptueux […] Ce sont des engagements qui effrayent mon égoïsme […] J’ai quand même peur que le souci de se préserver ne conduise à des sentiments parcimonieux […] Il me tarde de te revoir pour que tu me fasses part de ta sagesse et de tes découvertes. Je suis réduit pour l’instant aux inventaires du souvenir. L’appauvrissement du présent est sans doute l’essence même de la détention. C’est là une austérité qui n’a rien d’ascétique, et qui risque fort de paralyser une liberté privée d’exercice. Sujétion complète, absolue tutelle. Le champ de l’initiative est un étroit couloir, les projets sont morcelés par la fragmentation du temps. Vie d’absence et d’attente.
Je pense sans amertume mais avec un poignant désir aux jours lointains de la liberté retrouvée. Les joies que j’en attends ne pourront pas me décevoir, elles sont trop simples et trop pures. Au fait, elles sont déjà là, c’est le plaisir des retrouvailles, l’émotion sous l’humour, des amitiés grandies, et tant de choses à se dire. Il me faut veiller seulement à ne pas devenir un étranger. A ne rien faire tout seul, on joue un singulier personnage. Mais je ne veux pas assigner des formes concertées à mon expérience, qui se modèlera d’elle-même sur l’événement et sur la monotonie des jours.
J’ai vu mon avocat la semaine dernière. L’instruction du procès est quasiment terminée et je pourrais être jugé dans environ deux mois. Je tâcherai de dire les choses sans trop me faire d’illusions sur leur portée effective. La cause est entendue. Il me faudrait l’éloquence.
Dimanche. Tu n’as pas répondu aux questions que je te posais. Je voulais en particulier connaître ton adresse civile, si elle a changé. Je souhaite avec toi que s’apaise le dissentiment familial et que les grandes parties de gaîté reprennent, avec un rire de plus dans une maison heureuse.
Ce que tu m’écris de ta vie militaire m’inquiète beaucoup pour l’avenir de la France. J’ai l’impression déprimante qu’on vous entretient dans une oisiveté dorée et que la plaisanterie vous distrait trop facilement du « grand sérieux de la vie » ?.. Il est vrai qu’on a facilement la rate détendue sous les drapeaux. Que de bons moments, et comme il est bon de retrouver une enfance insoucieuse et bruyante. Nous nous en éloignons pourtant. Non que nous ayons perdu le goût de la blague, mais on a l’impression qu’au-dessus d’un certain âge, on n’a plus accès à certains rires débridés que la dignité interdit aux grandes personnes, et dont les gamins insolents se réservent le joyeux monopole. Je ne suis pas du tout disposé à me laisser faire. Quel plaisir d’aller chez toi, chez vous. On me dit que la cathédrale de Bourges n’est pas insignifiante. Tu me confirmeras svp.
Bientôt trois mois que je suis derrière ces hauts beaux gros murs. A certains moments j’ai le sentiment intense d’être heureux, ou en tout cas comblé de chance imméritée . Joie sur fond de peine, bien sûr, mais quand même une gratitude très profonde. Je suis étonné de m’en tirer à si bon compte. Mais je ne me flatte pas trop car tout n’est pas dit.
Je ne connaissais pas l’histoire des chiens policiers. J’en connais d’autres, bien sûr. La réalité dépasse la fiction. Ce sont des réflexions qui me sont familières au point de m’obséder. Ne trouves-tu pas que les Français sont d’une docilité extraordinaire eux qui si prétentieusement se croient et se disent les champions de la liberté? Que Dieu nous sauve, puisque nous en sommes incapables.
Valete et gaudete Jean Le Meur
Ivernel soigne un eczéma à Fribourg, mais il n’arrive pas à se guérir des idées subversives. Comme tu le dis il faudrait une bonne épuration.
[aux EOR du Matériel, j’avais choisi la spécialité auto-char, ce qui m’avait fait faire un stage de mécanique à Bourges, de trois ou quatre semaines. Je m’étais bien amusé, mais ma note fut pour catastrophique comparée à celle de mes concurrents, tous ou presque ingénieurs des Arts et Métiers]
Constantine le 14 mai 1959
Chère petite graine de sous-bitte (mais si, mais si) je te remercie de penser encore à l’oiseau en cage. N’oublie pas de me donner ton adresse civile, cré nom d’un chien, et quand les choses s’arrangeront du côté des géniteurs, dis-le moi, afin que j’aie un souci de moins.
Honnête performance pour le BSM. Avec tes grandes guiboles tu devrais améliorer ça. Mais les armes motorisées, ça ne sait pas marcher, c’est connu. Parlez-moi des chasseurs, et arrêtons la salade.
Les SAS, ça peut être la meilleure des choses (superlatif relatif) . Étant donné l’équivoque générale, avec un peu beaucoup de chance on peut même y faire de bonnes choses. Avant de sombrer dans l’extrémisme, tu sais que j’avais tenté de m’aventurer dans une direction semblable, mais qu’on avait brutalement arrêté l’expérience, ce qui avait précipité les choses. Mon expérience récente me rend intransigeant et je suis de mauvais conseil pour l’humilité des tâches quotidiennes (et de citer Verlaine…). Je crois quand même qu’il faut garder une grande vigilance et savoir dire merde au point de discernement. Ce ne sont pas là des renseignements très précis. J’ai bien un ou deux copains qui sont dans la partie, mais perdus de vue. Le peu d’officiers SAS que j’ai pu rencontrer ou entendre ne m’ont guère édifié: beaucoup de cons de bonne volonté, bonne conscience paternelle, et quelques salauds. Mais j’avais l’esprit prévenu, et rien n’empêche d’être l’exception qui confirme la règle. Ce que tu me dis me laisse penser qu’il y a des choses qui changent. Je reste essentiellement sceptique, et je ne crois pas beaucoup en cette affaire aux modifications de détail. Dieu fasse que je me trompe. Ma pâture quotidienne et hebdomadaire de papier journal me manque beaucoup. Il me tarde de lire l’Observateur. Dans un an, peut-être, on pourra de nouveau s’adonner à la toxicomanie.
Aucune nouvelle de mon procès. J’ai passé un soi-disant examen psychiatrique, et en suis revenu scandalisé : je ne taris pas de sarcasmes sur le dit psychiatre qui, je l’espère, a meilleure opinion de moi, sinon je suis bon pour le cabanon et la camisole de force, ce qui ne serait pas un progrès sur mon sort actuel. Le but de la manœuvre, si je puis dire, serait de décider que j’ai le ciboulot qui ne tourne pas rond, ergo gluc, que je me goure dans mes ratiocinations (sic), et que ceux qui ne pensent pas comme moi ont nécessairement raison comme le prophète, c.q.f.d.
J’ai ici quelques chants de l’Odyssée, mais je ne fais pas du tout de grec, pas de latin non plus. Du bout des lèvres je grignote un peu d’allemand. Mais une grosse flemme: le cœur n’y est pas. Je pense un peu trop à Wolf, le berger allemand, et à tout ce qui s’ensuit.
J’ai reçu d’Ivernel le théâtre de Brecht. Je marche très bien là-dedans, et je me désespère que ce langage soit démodé. Il me paraît pourtant assez pertinent.
Me voici un vieux de 27 ans. Je suppose que tu es aussi dans ces âges fatidiques. Il serait temps de commencer à vivre. Tu m’as l’air bien parti, d’un long pas nonchalant et vif. J’en suis encore à terminer mon noviciat. Si ça traîne, je ne pourrai plus que survivre. Des bouquins? Si tu es assez riche: Calvin Kentfield Le voyage de l’alchimiste (Seuil) Julien Green, Le Malfaiteur. Si Faulkner vaut la peine d’être connu, ce que tu crois le meilleur. Des textes de versions grecques et latines d’agrégation: c’est toujours mieux que des problèmes d’échecs. Et puis si tu vois quelque chose capable d’intéresser davantage un taulard (ou tôlard ?) déconfit et morose, invente mon vieux. Mais foin de la politique. Dieu te garde . Valete et gaudete Jean
Ivernel plus bon pour le service. Braunstein dans les agrégations. Tutti quanti dans le kaki qui perdent le goût d’écrire et peut-être me regardent de travers. Les honneurs du bled: contradiction dans les termes. Salut
On nous a en effet informés un jour de la possibilité -mais c’est sans doute Le Meur qui m’en avait inspiré l’idée – d’être volontaire pour les SAS, ce qui signifiait au moins dix-huit mois à passer en Algérie. Devenir officier des Affaires Algériennes, c’était donc la réalisation d’un défi : choisir d’affronter plutôt que d’esquiver –pour que mon grand-père n’ait pas honte de moi !- et de confronter mes idées anticolonialistes avec la réalité de ces » crouilles » – impardonnable déformation du beau mot rouhia, mon frère – que les pieds-noirs me reprochaient de ne pas connaître. C’était aussi l’aventure, l’excitation de retrouver la demi-douzaine de copains volontaires eux aussi pour cette aventure, Marseille, la poignante séparation d’avec Jacqueline que j’essaierais de faire venir auprès de moi si dans mon poste d’affectation une institutrice pouvait se faire nommer. Le quai était dans l’ombre, Notre-Dame de la Garde étincelait, ceux que je quittais étaient plus angoissés que moi, ayant remarqué que notre passerelle d’embarquement se trouvait en face de la sombre morgue, où seront rapatriés les corps des quelque vingt mille soldats français tués : certains s’en consolaient en se disant qu’après tout c’était moins que le nombre des morts sur les routes françaises ! Satisfaction pour les partisans de la manière forte, ceux qui pensaient qu’on » devait mettre le paquet » : on a laissé sur l’autre rive de la Méditerranée entre deux cents et quatre cents mille cadavres de rouhias . Beaucoup mieux que dans le rêve de certains tendres utopistes, par la suite sans doute déçus du résultat : en tuer dix pour un mort de notre côté , afin « d’être tranquilles » en Algérie. Et on a commencé à apprendre et à employer les euphémismes : FSNA et FSE, Français de Souche Nord Africaine et Français de Souche Européenne.
Arzew, découverte du Maghreb
Il était excitant de traverser la Méditerranée avec le statut d’officier sur le paquebot, de découvrir Alger la blanche où nous attendaient tous les dangers, de choisir une place dos au mur dans les cafés, l’œil aux aguets. Il y a eu aussi la découverte, d’Alger à Oran et à Arzew, d’une Algérie voluptueuse comme une enfance de Camus, avec les énormes olives violacées de la « kémia » (les tapas espagnoles, les mézés grecs), les filles provocantes, regards hardis et peau bronzée, les piscines et la mer.
Mais nous avons aussi respiré la puanteur du racisme, du fascisme même : lors de notre stage de formation à Arzew, un petit sous-lieutenant cornaquait les bleus que nous étions, sous-lieutenants comme lui ou aspirants. Nous le vouvoyions malgré nous, – et j’enrage encore de ne pas avoir eu la force de le tutoyer – impressionnés par son berger allemand, son pistolet à la ceinture, sa » banane » , croix de la valeur militaire, agrafée à son treillis : une allure de voyou glorieux, sadique et distingué. Nous l’imaginions sur quelque fortin assiégé par les » salopards « , comme dans la chanson d’Edith Piaf, résistant avec héroïsme jusqu’au bout du massacre, alors que toute sa gloire consistait peut-être à avoir appliqué la « gégène » ou la baignoire à quelques suspects. L’image de l’officier pacificateur décrit par les instructions officielles en prenait un coup, d’entrée de jeu.
Et les « cours » non plus n’étaient guère faits pour nous préparer à une action de pacification : le jeune prétentieux nous apprenait à manier le poignard en close-combat, sans doute pour nous bizuter plus que pour nous former à une vie que nous devrions perpétuellement défendre à coups de couteau. Comme aux EOR, des cours sur la civilisation arabo-musulmane ressortait essentiellement ceci : qu’il n’y en avait pas, ou guère. Parfois, trop rarement, la parole d’un des inspirateurs des S.A.S. – peut-être un ancien des Affaires Indigènes de Lyautey -, tentait de nous initier au respect, aux règles de politesse de ce monde inconnu. Avec ce sage conseil, que j’ai pu si souvent vérifier : dans l’ignorance, appliquez strictement vos propres règles de courtoisie, – même si elles sont en contradiction avec les règles locales – elles seront toujours ressenties et appréciées par ce peuple, certes parfois cruel, mais d’une noblesse quasiment médiévale ou cornélienne. Malgré les quolibets de mon capitaine et des autres militaires, j’ai toujours appelé les Algériennes » Madame » et n’ai tutoyé personne, même si je me faisais tutoyer par des arabophones qui ignorent le vouvoiement : ridicule aux yeux des autres Européens, je sais que cette attitude m’a valu un respect réciproque, car tous ces « tutoyeurs » arabes se rendaient bien compte que les » Européens » se vouvoyaient.
Ayant pris mon poste en juillet 59, comme adjoint au chef de SAS de Morsott, je dus en assurer l’intérim jusqu’au retour du capitaine Pichereau.
Dès ma prise de fonctions, il se produisit un grave incident qui, sans que j’en aie eu bien conscience, a déterminé mes relations, et celles de ma femme, avec la population locale durant les dix-huit mois de notre séjour . Ces relations furent les moins mauvaises possible dans ce contexte pesant, car, à la suite de ce drame initial, elles sont restées fondées sur la confiance. Rapports quasi féodaux, sens de l’honneur sur fond de violence et de cruauté. L’événement déterminant de notre « intégration » à Morsott est une histoire tragique à partir de laquelle se sont développées ces relations tacites, presque de complicité, empreintes de respect mutuel, avec l’ensemble de la population, si ce n’est avec les » rebelles » .
Donc, quelques jours à peine après mon arrivée à la SAS de Morsott, le maire, M. Zarroug, est venu, sourdement indigné, (pris entre deux feux, ne sachant pas quelle pouvait être la réaction de ce jeune officier novice) me signaler l’intervention violente, dans un douar, d’une harka étrangère à notre sous-secteur, sous les ordres d’un capitaine « FSE » . Je devais aller constater les faits avec le maire. Je l’embarquai dans ma jeep, avec un chauffeur et un seul moghazni. Celui-ci avait un P.M. et moi mon pistolet d’ordonnance, armes dérisoires en terrain réputé dangereux, surtout dans ces circonstances. Le douar, ses gourbis, cailloux sur cailloux, le tout uniformément beige grisâtre, sans plus de verdure que quelques figuiers de barbarie, presque invisible dans son camouflage naturel ton sur ton, se signalait par la fumée et les ululements des femmes. De près, c’était la puanteur des charognes : celles de quelques animaux et d’un homme égorgé, fermentant au soleil. Des misères brûlées continuaient de fumer. Les femmes s’étaient déchiré le front avec leurs ongles, sans cesser une seconde de hurler, et la cendre qu’elles s’étaient répandue sur la tête se mêlait au sang. Les vieillards, impassibilité noble et résignée, seigneurs déchus dans leurs djellaba en haillons, nous ont offert le » cahoua « , breuvage noir et boueux qu’il fallait disputer aux mouches, assoiffées sans doute pour s’être trop régalées de cadavres. Comment, dans ce déchaînement de brutalité où tout était permis aux » forces de l’ordre « , violence tacitement admise dans l’ensemble de l’Armée contre ces adversaires insaisissables, ne pas supposer que les femmes aussi avaient été violées ? Mais le tabou sexuel était tel, dans ces populations, que les hommes auraient préféré tuer les femmes » déshonorées » dont le déshonneur souillait toute leur communauté, ou tous se faire tuer, plutôt que d’avouer cette ignominie en portant plainte. J’ai dit nobles , c’est l’antonyme d’ignoble.
J’ai porté plainte à la gendarmerie. A peine goguenards devant ma naïveté, réglementaires, les gendarmes ont instruit la plainte, sous la pression aussi du colonel Kretz, du 26ème d’infanterie, indigné de l’affaire et de cette intervention dans son sous-secteur d’une unité extérieure. Les gendarmes sont allés au douar à plusieurs, avec mitrailleuse et tous fortement armés, prendre les dépositions, mesurer, compter, décompter, établir leur rapport pour meurtre, destructions et brutalités. Dix-huit mois plus tard, à mon départ, le dossier n’avait toujours pas abouti, mais les » Arabes » , sans doute plutôt des Chaouias, me rappelaient discrètement ma réaction « courageuse » dans cette affaire ; avec le recul je la jugeais seulement candide et imprudente, mais je reste persuadé que cette imprudence m’avait protégé dans ce pays aux mœurs quasi féodales : ni l’honneur ni l’intérêt militaire ne permettaient aux fellaghas d’attaquer des hommes aussi faiblement armés. Quant aux harkis de ce capitaine, quel a pu être leur sort le jour de l’indépendance ? L’officier français, lui, n’a pas, à ma connaissance, été inquiété, mais il s’est sans doute indigné, comme d’autres bonnes âmes, que la population ait voulu se venger sur les harkis qui n’avaient été que les exécuteurs de ses basses œuvres.
Dans Le Monde du 24 avril 2001, on annonce la découverte d’un « grand charnier » datant de la guerre d’Algérie, dans la région de Tebessa. Les squelettes (déjà 290) ont été trouvés lors de travaux de terrassement sur l’emplacement de ce qui était à l’époque la S.A.S. de Chréa.
Me revient en mémoire le sergent-chef qu’on surnommait Roquevert pour sa ressemblance avec l’acteur (Sergent chef P). C’est lui qui m’avait confié en juillet 59 son écoeurement lorsqu’il repensait à cette région –n’était-ce pas Chréa ?- où tous les puits avaient été comblés et empoisonnés par les cadavres que la répression féroce exercée par des militaires français, y avaient jetés et entassés. J’avais alors noté ceci dans son témoignage: » dans un campement disciplinaire à 50 km de Chéria- et non Chréa ?-, en 1959, le GMS n°5 (j’ai noté aussi » le DOP 60 » ?) a opéré une répression, sur dénonciation d’un caporal-chef arrêté comme fellagha . Le sous-officier français me disait : » On en emmenait 40 ou 50 tous les soirs, par pleins camions. Les puits en sont remplis. On peut juger à l’odeur en passant à côté. Ils ont égorgé devant moi un pauvre type qui donnait des renseignements « . Le caporal-chef délateur « avait plein d’argent, et à l’époque la solde n’était que de 38.000 francs par mois « . Et aussi à propos du poste de Guentis, à l’ouest de Tebessa, où des tirailleurs algériens s’étaient soulevés, en mai 59 : dans la répression qui s’était ensuivie, » on en pendait partout, par les pieds ou le cou » … Également dans cette belle ville de Tébessa, où je me suis fait faire mon képi bleu de SAS, ces ruelles en pente avaient vu, dit-on, couler des torrents de sang quand les légionnaires l’avaient » pacifiée « . Mais on y allait, de Morsott, comme à la grande ville, et nous y déjeunions au restaurant.
J’arrivais donc en Algérie, comme aspirant, pour prendre l’intérim de mon capitaine parti en permission en France. C’est là que j’ai rencontré ce sergent-chef. La S.A.S. (section administrative spécialisée) de Morsott, au nord de Tebessa, était établie, en attendant ses bâtiments neufs, dans un vieux bordj à la limite sud du village, à côté de l’abattoir ! J’y ai vécu quelques semaines, appréciant, dans cet été brûlant mais sec des Aurès, la climatisation » écologique « , comme on ne disait pas encore : je versais sur le sol l’eau d’une » gargoulette « , grande poterie poreuse décorée de sobres motifs berbères, puis je la remplissais et la laissais transpirer toute la nuit. La lettre de bienvenue de mon capitaine Pichereau m’attribua ensuite une villa dans les bâtiments neufs de la SAS, une demi-douzaine de villas et un bâtiment administratif dans une enceinte fermée mais plus » civile » et accueillante que le vieux bordj : » Installez-vous dans la villa qui avait été prêtée au Caïd Mokrad. Demandez à ce dernier de mettre ses meubles au Dar el askri –après avoir pris contact pour accord avec le maire de Morsott [Zarroug], bien entendu. » Quand Jacqueline a pris son poste à l’école, Pichereau nous enverra habiter la rudimentaire mais très agréable baraque Fillod, au centre du village, prévue pour loger un enseignant, où nous sommes restés jusqu’à la fin.
L’école dans la guerre
Le long de la ligne qui me menait de Bône à Morsott » petite bourgade déshéritée et sans avenir » , selon un précédent rapport administratif, il nous arrivait, nous les » bleus » en kaki, d’échanger des signes amicaux avec les gosses qui nous regardaient passer. Sur le quai de la gare de Soukh Ahras, j’en ai vu un, de huit ou dix ans, qui m’a répondu par une mimique obscène et injurieuse. J’avais hérité de cette affectation dans un bled perdu parce que mes notes d’EOR étaient médiocres, et qu’une institutrice y était vivement souhaitée, une » vraie « , venant de la métropole : Jacqueline pourrait venir m’y retrouver et « faire la guerre » avec moi.
Le directeur de l’école avait accédé à cette fonction par le rang : il m’a confié avoir suivi ses études secondaires » jusqu’au brevet « . Un bâtiment d’école encore présentable existait, non loin de la petite gare, mais bien trop petit pour les ambitions de scolarisation universelle d’une Algérie que nous voulions française, résolument, depuis si peu de temps, c’est à dire depuis que la rébellion s’était généralisée. La mission de l’armée française était en fait, sous cette pression – à proprement parler « le couteau sous la gorge » -, de réaliser, en quelques mois ou années, ce que la colonisation, disons l’administration, n’avait pas pu ou voulu faire pendant plus d’un siècle : établir enfin sur cette terre la liberté, l’égalité et la fraternité. Dans un secteur voisin, un colonel avait pu se vanter d’avoir scolarisé les enfants à cent pour cent : au début octobre les soldats, sans ménagements superflus envers la population » arriérée » des douars, avaient rassemblé plus de cent » élèves « , amenés en GMC, sous une immense khaïma ; on avait mis devant eux un sergent licencié en droit et on les avait déclarés scolarisés avant qu’ils ne retournent chez eux par petits groupes pour ne plus jamais revenir.
C’était plus sérieux à Morsott, où s’achevait la construction d’une nouvelle école, seul bâtiment neuf, avec la somptueuse gendarmerie. Là, Jacqueline, de toutes ses années d’institutrice connaîtra les plus attachants de ses élèves, les plus passionnés, les plus misérables aussi. Certains commençaient leur scolarité primaire à treize ans. La scolarité, pour les plus grands, souvent quasiment analphabètes, continuait dans le Centre de Formation de la Jeunesse Algérienne, administré par un sous-lieutenant instituteur, Fleurigeon. Ces grands élèves – uniquement des garçons, car à l’âge du collège les filles étaient nubiles, donc recluses et voilées -, étaient censés recevoir là une formation qui leur ouvrirait les portes de la vie professionnelle. Notre ami F. se montrait amèrement déçu quant aux débouchés offerts, extrêmement rares, voire inexistants.
J’ai la peur au ventre, surtout au début, quand, après le dîner au mess du régiment avec lequel la SAS cohabite, traversant le village déserté par le couvre-feu, je rentre seul à mon bordj. Je me hâte de déclarer mon identité en réponse au » Achkoun ? » ( » Qui va là ? ») de la sentinelle et au sourd cliquetis du fusil qu’elle arme. C’était en juillet 1959, les nuits étaient d’une brûlante sécheresse, un peu tempérée par la gargoulette, dont le contenu, vite évaporé, avait aspergé le sol..
Le sexe dans la guerre
Le capitaine de la SAS, avant que nous ayons nos nouvelles maisons, vivait au cœur du village, dans une assez jolie villa aux volets clos. Un jour que je tentais de le joindre pour une urgence, j’ai frappé en vain chez lui. Je n’ai eu que le temps d’apercevoir furtivement une main lourdement baguée, aux ongles longs et rouges, qui fermait vite un dernier volet entrouvert. On racontait que le propriétaire d’un bordel, dans une petite ville voisine, El Meridj ?,fournissait chaque mois à notre capitaine une nouvelle odalisque. « On, c’est des cons », me répliquait le capitaine quand je lui rapportais des on-dit plus sérieux
Ce qu’évoque Jacques Brel dans sa chanson » Au suivant ! « , correspondait à une réalité administrative pour les légionnaires, soldats de métier et non pas appelés : c’était le BMC, bordel militaire de campagne, qui un jour a planté sa tente vaste et confortable –comme un cirque ?- aux portes de Morsott. Comme pour un cirque, avec ses jongleurs et ses animaux, toute la population, et les militaires autres que les légionnaires, ont dû se contenter de voir une sorte de parade dans les rues du bourg : ces dames, moins provocantes qu’on ne l’aurait pensé (et obscurément souhaité ?) , assez dignes, entourées par la courtoisie mondaine, un peu caricaturale, des officiers de la Légion. Pour les Arabes, en majorité d’ailleurs ici plutôt des Berbères, des Chaouias, ce devait être violemment scandaleux et tentant, eux dont les femmes portaient le voile intégral –des Françaises, selon les critères nationalistes de l’époque!
Il ne restait dans cette bourgade trop pauvre qu’une » pied-noir « , la veuve d’un technicien qui avait été employé à la construction du chemin de fer SNCFA de Bône à Tebessa dont Morsott était l’avant-dernière station. Les autres FSE étaient les institutrices ou de très rares femmes ou filles de militaires.
Pour les satisfactions sexuelles des militaires, dont ceux de métier n’en finissaient pas de regretter le bon temps de l’Indochine et de ses douces » congaïs « , il existait dans toutes les villes un peu importantes des établissements en dur , plus fournis, semble-t-il, par des métropolitaines que par les légendaires Ouled Naïl, dont André Gide avait apprécié les charmes raffinés. Autre spécificité de cette France d’outre-Méditerranée : les bordels n’y avaient pas été interdits. Entre autres charmes, puisque les FSNA ne les fréquentaient pas, c’étaient pour les FSE des lieux publics plus sécurisés que les cafés.
La torture et retour à Jean Le Meur
Quand avons-nous su que le personnage le plus connu dans cette guerre -qui n’a avoué son nom qu’en I999- était la » gégène « , la génératrice électrique destinée à obtenir les aveux des suspects ? Depuis toujours, je crois, sans oser en parler vraiment, comme s’il s’agissait plus d’un mythe, d’une provocation contre les opposants, d’une blague un peu lourde pour effrayer les bleus, pour tester leurs » couilles » , pour savoir s’ils étaient de » bons Français » – ou des séides de » l’anti-France » pervertis par les » intellectuels « , comme le Juif bradeur d’Empire Mendès-France ou, pire encore, le renégat, l’apostat, le traître François Mauriac qui osait, avec une poignée d’autres, accuser l’Armée française d’utiliser la torture pour mener à bien sa mission » de pacification, de justice et de civilisation « . Cette anti-France dont les représentants étaient Camus, Alleg, Audin, le général Paris de la Bollardière, et mon ami Jean le Meur.
[sous le cachet CENSURE PRISON MILITAIRE] Constantine le 6 juillet [59]
Il y a deux ou trois jours j’ai reçu les bouquins (Faulkner et Calvin Kentfield) et aujourd’hui ta lettre d’Arzew. Je t’écris sur l’Alchimiste et sur du vieux papier avec un mauvais stylo et une posture ad hoc, ce qui t’expliquera ces défaillances de ma calligraphie.
Quelques références biographiques : le 25 juin j’ai été condamné à deux ans de prison. Il n’a pas été question de m’enlever mon grade. C’est peut-être un oubli. J’ai signé un pourvoi en cassation qui sera rejeté. Mais tant qu’il est en instance je suis toujours au régime des prévenus et je peux écrire autant et à qui je veux (si j’ose ainsi parler). Le mois prochain et ceux qui suivront ne t’attends pas à me lire. Raison de plus pour m’écrire à cette fin de m’entretenir le moral. Une chose que j’oubliais : ma prison s’achèvera le 10 octobre 1960. Après ? A chaque jour suffit sa peine. Je souhaite vivement que tu essayes de me voir si tu passes à Constantine. Je crois qu’il n’y aura pas de difficulté, seulement une démarche chez les autorités judiciaires. On t’expliquera à la prison (Pénitencier militaire, tout près de la caserne Casbah) Les visites ont lieu l’après-midi, vers 3 h. Je te donne ces précisions pour t’épargner des déconvenues.
Je ne comprends pas très bien tout ce que tu me dis de J. Mais j’aime la manière dont tu le dis. Il me semble qu’il y a comme un gage de solidité et de permanence .
Un S/Lt de ma promotion avait été affecté à Arzew. Mais où? Il était de ma section: Malleval, un gars du pays à Borgeaud, avec des moustaches un peu tombantes. Sympa. Dis-lui bonjour si tu le vois. Si tu ne peux me voir, envoie-moi dès que possible toutes précisions sur ta nouvelle affectation, et même ton S.P. bougre de nom d’un chien. Sont-ils empotés les bleus! Heureusement que le vaguemestre appose sa marque de fabrique..
Bonjour à Voltz. Prévost était à Cherchell aux dernières nouvelles. Ivernel (les assonances!) bientôt remercié. Mon frangin curé vient au mois d’août faire l’aumônier qq part dans la région de Constantine. Je te l’enverrai pour te convertir. Merci des bouquins. Faulkner me fait froid dans le dos. Je l’aborde par la bande, du bout des lèvres sans avoir encore fait le plongeon. Dans la difficulté où je suis de lire assidûment je devrais me mettre à écrire. Mais la difficulté est sans doute polyvalente. Donc si tu peux viens me voir avant la fin de juillet. Et si tu ne peux pas, remettons à plus tard.
Je ne m’étonne pas des contradictions qui te frappent. Le déchirement me surprend un peu mais je manque d’éléments pour en juger. Pour ma part j’ai toujours été sidéré de la bonne conscience pataude que montraient la plupart de ces messieurs. Je pense qu’il faut prendre personnellement des engagements très précis. Et je pense aussi qu’il n’est pas facile de les tenir. pour démêler un peu l’univers de la confusion et simplement pour ne pas aggraver le chaos. Mais si nous ne le faisons pas, qui le fera ?
Que tu fasses venir ta femme n’est sans doute pas impossible. Il faut bien reconnaître que c’est courir de nouveaux risques, qui peuvent aussi être des chances. Du moment qu’on y va les yeux ouverts je ne serais pas contre. Si c’est par manière de jeu, il faut résolument dire non. Je te souhaite courage et clairvoyance mon cher petit. Inch’Allah !
Et puis si tu peux tu viens me faire une bonne surprise.
Jean le Meur S.P.86.147 Tu me parles d’un lieut. « rappelé ». Est-ce qu’on rappelle toujours des off. de réserve? -pas reçu de version. -Pour du décousu, c’est du cousu main!
Constantine le 27 juillet 1959
Bien reçu tes deux lettres avec les paquets d’humanités. Grazie. Je ne voulais pas te répondre puisque tu voyageais. Nous voici comme qui dirait voisins. J’ai presque fait mon deuil de ta visite, car si tu dois attendre le retour des patrons, je risque fort de ne plus être visible au bout de cette éternité. Je t’ai dit pourquoi.
Mon frangin est toujours quelque part en Bretagne. Il doit -devrait- venir au mois d’août prêcher la bonne parole, en guise de période militaire, je crois. Mais où?
Pourquoi t’étonner que j’aie été condamné? Tu ne t’attendais quand même pas à ce qu’on me décore? On dirait vraiment que tu veux ruiner la discipline. Tu me parais un élément dangereux. Je n’ai pas compris l’allusion que tu faisais à l’A.P. J’y ai flairé des relents de mauvais esprit (tout esprit est mauvais) et une tendance au dogmatisme simpliste, qui se manifeste par le désir d’une vision cohérente des choses. Après un stage à Arzew tu devrais quand même être édifié sur la permanence protéiforme de la dialectique, cette espèce d’auberge espagnole. Hegel à l’équarrissage. Je t’assure que de mon temps c’était du beau travail qui laissait baba maint EOR. Pour moi, c’était à me décourager du canular : nos imaginations sont si pauvres à côté de la luxuriante réalité.
Si d’aventure tu venais en dehors des heures ouvrables, n’apporte pas de colis de graille: on te remercierait poliment. De la lecture, si tu veux, savante ou frivole, sans explosif. Tu me donneras avec un peu plus de précision l’azimut de Morsott. J’ai un copain, Morel, sous bitte au 151° RIM. Je crois que c’est vers Bône. Mais où?
Beaucoup de copains doivent être dans les agrégations et les résultats imminents de l’oral. Peu de nouvelles de ce côté. Les autres sont dans le Djebel, et ne sont pas non plus très causants. Je comprends ça. Ivernel traîne de permission en prolongation jusqu’à la réforme définitive, et m’aide bien. Toi aussi, tiens bon. Pour moi c’est simple comme une route nationale, avec un terminus (sauf prolongation, dii avertant). Pour toi c’est une invention de tous les jours, pour marcher sans passer le point de discernement. J’ai un peu la frousse. Tiens-moi au courant, si tu veux. Vale et gaude Jean Le Meur SP 86.147
Mais je serais bien content de te voir. Comme disaient les Grecs
τόύςςα νή πάγη (je ne garantis pas l’accentuation) [phonétique: « tout ça n’est pas gai »]
Je dois dire que jamais, ni dans la SAS de Morsott ni dans les régiments –infanterie, cavalerie et légion- qui la côtoyaient, je n’ai eu de preuve directe d’utilisation de la gégène, ni dans la gendarmerie flambant neuve, seul bâtiment à deux étages, que nous avons laissée comme dernier témoignage de la » pacification « , avec l’école et les villas de la SAS, avant d’abandonner le pays aux « fells », » fellaghas « , « fellouzes » ou rebelles. Mais voulais-je vraiment le savoir ? Qui admettait de le savoir ? D’après sa fille venue passer quelques jours au 26ème d’infanterie, le colonel K. a été bouleversé d’apprendre que mon ami S., aussi colossal que son sergent S. « secouait » sérieusement les suspects pour leur arracher des renseignements. Le sous-lieutenant S., Français de Souche Européenne, FSE, un des rares pieds-noirs que j’aie connus sachant parler arabe, était chargé, avec son sergent berbère, originaire comme lui de l’ouest algérien, du deuxième bureau. La gégène, avec sa complice » la baignoire « , était-elle réservée aux villas d’Alger, ou des grandes villes, là où des hommes politiques d’extrême-droite, en mal d’héroïsme guerrier, passaient confortablement quelques mois à interroger traîtres et suspects (comme Jean-Marie Le Pen à la villa Sésini) ? Un truc de citadins pervers, en somme, ou une taquinerie pour faire encore râler l’ » anti-France « .
Pour le pittoresque : la fille du colonel K avait suivi à Coëtquidan les cours de français du professeur Seebacher, responsable de la cellule communiste de Louis-le-Grand quand nous étions en khagne, et qui passa dans le confort de cette école son service militaire en enseignant à des élèves-officiers d’active. Mademoiselle K fut horrifiée d’apprendre son appartenance politique. La plupart des communistes, dont le Parti avait voté les pouvoirs spéciaux, avaient choisi la discrétion .
Autour des Moghaznis et autres « Français de souche nord-africaine »
Un jour mon » ordonnance « , le moghazni Lazhari Abaïdia, s’est plaint à moi qu’un gendarme de Morsott, le trouvant » suspect « , l’avait giflé. J’aimais beaucoup ce jeune homme malicieux que le capitaine m’avait attribué en le traitant de » con « , et mettant son point d’honneur et sa réelle intelligence de presque illettré à » jouer au con » avec le capitaine et à remplir les missions les plus délicates et compliquées que je lui confiais, nous amusant tous deux de cet exercice pédagogique. Lâchement, faute de preuve, je n’ai pas engueulé le gendarme. J’ai choqué Lazhari deux fois : en le remerciant de m’avoir apporté un colis contenant un saucisson de l’Ardèche (la répulsion envers le porc, hallouf, était autrement plus forte chez ces hommes frottés à l’armée française que l’interdiction de l’alcool) ; la deuxième fois en faisant allusion à ma nudité quand, étant sous ma douche, je lui ai demandé de m’attendre pour me remettre une lettre : on mesure difficilement à quel point les Musulmans portent la pudeur, quelles que puissent être par ailleurs leurs mœurs réelles, qui ne sont pas différentes des nôtres.
De bons gendarmes aussi : j’ai apprécié à Bône, en 1960, cette admirable force républicaine, un régiment restant impavide sous les injures et les ordures jetées sur eux pendant des heures par une foule de pieds-noirs surexcités ; l’ordre fut maintenu, par ces hommes disciplinés, plus âgés en moyenne que les appelés du contingent, pas un mort, pas un blessé grave…
Avec S. et son sergent, auxquels les FSNA, prudents plus qu’amicaux, prodiguaient les cadeaux (couvertures tissées à la main, pâtisseries rances et sucrées), nous allions parfois goûter des brochettes dans un misérable boui-boui du village, dont la seule ouverture, la porte, était protégée du soleil par un rideau sale. Les abats grillés et épicés sentaient merveilleusement bon, la bière était fraîche, on avait l’illusion de quelques moments de bonheur et de fraternité. Un jour, je cherchais S. pour l’amener déjeuner avec nous, dans la baraque Fillod où l’administration nous avait logés, près de la vieille école. C’était somptueux, nous avions trois pièces, une cuisine et une salle de bain, et le plus souvent de l’eau courante, froide et chaude, grâce à notre situation en contre-bas du village. Nos amis appréciaient cette présence féminine, cette atmosphère civile . Nous aimions bien S., sa stature athlétique, son bon sourire aux yeux bleus. Comme » ancien « , et arabisant, il nous impressionnait aussi un peu. Son sergent nous a fait un jour une « chorba », la soupe savoureuse et nourrissante qui rompait le jeûne du ramadan. Le sergent S. se suicidera peu après son arrivée au camp de Rivesaltes où, après la guerre, on accueillait les F.S.N.A., harkis et moghaznis, qui avaient pu fuir l’Algérie dévastée par la haine, la vengeance et la terreur dans lesquelles rivalisaient le F.L.N., le M.N.A. et l’O.A.S.
Ce jour-là, un beau jour d’été, je suis allé chercher S. dans son » Deuxième bureau « . Un soldat m’a envoyé vers une petite cabane non loin du chemin de fer. J’y arrivais quand un vieil homme en sortait, suivi de S. Le » chibani » avait le visage en sang, il marchait péniblement, soutenu par un jeune adolescent qui m’a fixé une seconde de ses yeux flamboyants, inoubliables. Qui de nous quatre a oublié, aujourd’hui, cinquante ans plus tard ? S., gêné, m’a expliqué que ce vieux têtu refusait de lui dire où étaient passés les fellouzes cette nuit, et qu’il avait bien fallu le secouer un peu. Je lui ai demandé ce qu’il pensait de l’effet » pacificateur » produit sur le fils et les autres villageois. Une plaisanterie au moins ambiguë au mess : S. se vantant auprès de Jacqueline –institutrice admise là en tant que femme du sous-lieutenant SAS- d’obtenir des renseignements grâce à sa » pince à tirer les vers du nez « . Vieillards et enfants : tous les autres hommes, en âge de porter les armes, avaient disparu de ce pays, soit enrôlés dans l’armée française, soit, dix fois plus, » de l’autre côté « . La situation leur interdisait de rester neutres : ils ne pouvaient, au mieux, qu’être suspects, et traités comme tels.
Un autre copain sous-lieutenant, K., séminariste et devenu plus tard une sommité de la recherche biblique, s’était découvert une passion militaire où il défoulait sans doute le trop-plein de sa vitalité rougeaude et trop chaste; courageux » commando « , il préconisait le coup de crosse de pistolet-mitrailleur dans le ventre des vieux chibanis pour leur faire avouer que cette nuit le couscous trouvé fumant dans un douar isolé n’avait pas été préparé pour la patrouille française. Ces jeunes officiers du contingent étaient à peine plus réservés pour faire allusion- en tentant de ne pas se faire entendre des deux femmes qui mangeaient avec nous à la table du mess- aux oreilles que leurs braves » commandos Challe » avaient prélevées sur les cadavres de rebelles abattus dans une zone trop dangereuse pour qu’on les rapporte entiers, comme preuve de vaillance victorieuse. » Il fallait bien les comprendre » , mais mes camarades faisaient mine de désapprouver un tel procédé et l’obscénité de cette image: ces bouts de cartilage blêmes, à peine noircis de sang séché, exhibés dans un mouchoir sale qu’un jeune héros de l’armée française tirait de sa poche pour les montrer à son sous-lieutenant.
Encore un sous-lieutenant de ces commandos, baroudeur courageux et dévoué, notre ami P. L., s’est jugé lui aussi trahi par De Gaulle. A sa libération début 61?, il s’est fait prendre avec deux armes dans sa valise et emprisonner comme OAS. Cocasse : me croyant » du bon bord » alors que l’Intérieur voulait annuler ma nomination à l’Étranger en tant que membre du comité Audin, son frère m’a demandé d’intervenir en faveur de Patrice. Les OAS condamnés que j’ai croisés plus tard à l’Ambassade de France en Argentine étaient moins sympathiques. On a vite appris qu’ils » conseillaient « , forts de leur expérience de tortionnaires, déjà sous Peron vieillissant puis sous la dictature militaire à partir de 1976, les spécialistes de la répression.
Haine, préjugés, racisme, mais surtout imbécillité et ambiguïté de l’armée française : dans le régiment du colonel K. (26ème d’infanterie), un de nos amis sous-lieutenants était FSNA, arabe ou kabyle, du nom de Dahmani. Il avait donc choisi son camp. Or il attendait depuis six ans d’être promu lieutenant, comme nous l’étions tous, appelés ou d’active, au bout de deux ans. Bon officier, il n’en était apparemment pas révolté. Mais voulait-on lui faire confiance ou le pousser dans les bras du FLN, comme celui qu’on n’avait jamais voulu promouvoir, l’adjudant-chef Ben Bella, qui dans les djebels devait faire la nique aux généraux français si méfiants ou méprisants ?! A la même époque ses presque homonymes, les frères Rahmani, capitaines je crois, avaient protesté contre la même injustice absurde, qui leur interdisait de passer officiers supérieurs.
» Monsieur le Président, je vous fais une lettre … « , chantait le déserteur de Boris Vian à l’époque. Président Jacques Chirac, vous avez pris en 2001, des mines effarouchées devant le livre où un officier devenu le général Aussaresses revendique la torture et l’assassinat des prisonniers rebelles. Camarade sous-lieutenant Chirac, aurais-tu été le seul, dans notre armée de » Maintien de l’Ordre » en Algérie, à n’avoir pas entendu parler de Madame la Gégène ? pour parler comme écrivait l’auteur maladroit d’une lettre ambiguë trouvée sur un cadavre en 1960 : une nuit, les Fells avaient exécuté – dans ce sous-secteur » pacifié » pendant le jour par notre armée -, un paysan pour trahison (avait-il parlé ?) . Nous avons trouvé le cadavre égorgé, avec une feuille de cahier scolaire épinglée sur sa poitrine. L’égorgement, qu’on appelait » le grand sourire » ou » sourire kabyle » n’était pas l’estafilade qu’on voit dans les films : cela bâillait d’une épaule à l’autre, comme une éventration ouverte sur un magma de bulles, de muqueuses et de cartilages sanguinolents.
Le » traître » n’était sans doute pas de la pire espèce, parce qu’on lui avait fait l’honneur de l’égorger, qu’on avait épargné à sa mémoire, à sa famille, à sa tribu, l’humiliation suprême d’une balle dans la nuque. Et la lettre disait, pour le moins curieusement, que » Madame la France « , de toute façon, n’appréciait nullement sa trahison.
Cette exécution était-elle due au groupe du lieutenant Mohammed ben Youssef sidi Yahia, qui avec une poignée d’hommes, tenait la nuit ce territoire » pacifié « , bien délimité entre les zones interdites et la ligne Challe , dans une boucle de laquelle se lovait Morsott ? On pouvait, on devait tirer à vue sur tout individu aperçu dans ces zones interdites, vidées de leurs habitants regroupés dans des camps comme celui d’Ouenza ou de Bou-Khadra, près des mines de fer. Un jour un camarade sous-lieutenant a ordonné d’ouvrir le feu d’un fusil-mitrailleur sur une silhouette en djellaba, qui courait à quelque trois cents mètres. Le soldat, par un hasard improbable, a touché cette cible si lointaine. La section est allée ramasser le cadavre d’un gamin de douze ans qui courait derrière une chèvre égarée. Notre camarade s’en remettait mal, pestant » qu’est-ce qu’il allait foutre là, ce petit con… « . On est près du film L’Ennemi intime .
C’est par hasard aussi qu’a été tué Mohammed ben Youssef Sidi Yahia. Revenant d’une opération, un de nos avions a aperçu une demi-douzaine d’hommes armés galopant en zone interdite. Une bombe au napalm a grièvement brûlé ce lieutenant FLN, dont nous savions bien des choses, sinon son curriculum complet, et que plusieurs de nous estimaient soit pour sa valeur militaire (il faisait pièce, la nuit, avec quatre ou cinq hommes, à tout un régiment, plus le maghzen de la SAS), soit pour ce qui me semblait de la justice dans son « administration » du territoire. Il avait cent fois échappé de justesse aux patrouilles de nuit, qui se vengeaient en mangeant le couscous encore fumant que préparaient pour lui les paysans, ce qui leur valait de sérieux passages à tabac : l’Armée, c’était l’ordre et la seule légalité.
Quand un commando – ou notre maghzen – arrivait dans une mechta sur les talons des « fellaghas « , il n’y trouvait que des vieillards murés dans une muette imbécillité, des enfants aux yeux énormes et noirs de terreur, et des femmes blafardes qui, terrées au fond de leur gourbi, ululaient sans fin sur un ton strident. Des traces de sabots dans le fond de l’oued, invisible depuis la plaine : les soldats furetaient dans toutes les anfractuosités ombreuses où les Fells auraient pu se réfugier. Quelques jours après mon départ, un de mes camarades s’est effectivement trouvé face à face avec un de ces soldats de l’ombre . Et les deux jeunes hommes, également surpris, se sont entretués, l’un en plein soleil, l’autre au fond de l’obscurité d’un midi éclatant.
Le lieutenant Mohammed ben Youssef a survécu quelques heures à l’hôpital de Tebessa. Il a refusé de parler à un officier d’un grade inférieur ou équivalent au sien. Impressionnés par son courage et sa dignité –le monde aux codes quasi cornéliens que j’ai cru souvent côtoyer dans ces Aurès Nementchas peuplés de Chaouias-, reconnaissant un adversaire digne et courageux, les militaires ont fait venir un capitaine, qui n’a pu que constater sa mort. C’est à ce genre de combattants que s’adressait l’offre de » Paix des braves « , politique lancée en 59 ; les » modèles de discours » que la hiérarchie nous adressait pour être lus à la population prenaient celle-ci pour une bande de demeurés. L’imbécillité était en réalité celle des » psychologues » de l’Armée qui » savaient, eux, comment on parle à ces gens-là » . Je cite textuellement :
» L’Armée ne parle pas beaucoup –parce que les Hommes Forts ne parlent pas beaucoup. Ils n’ont pas besoin de parler –car tout le monde sait qu’ils sont forts . Par contre les Fellaghas parlent beaucoup pour cacher leur faiblesse. De Gaulle a offert aux Fellaghas la » PAIX DES BRAVES « , à condition, naturellement que les Fellaghas cessent de mal se conduire vis-à-vis de la famille qu’est la France… etc »
Bien différent, et si supérieur ! , était le style des tracts FLN incitant les Légionnaires à déserter : » Ce que l’on vous demande, c’est de massacrer l’Algérien, que les cadres français de votre Légion vous présentent comme un être fanatique et rétrograde, pour maintenir la domination du plus fort… L’A.L.N. est une armée du peuple, d’un peuple qui s’est soulevé pour abattre un régime insupportable, d’un peuple qui entend arracher son indépendance … »
Deux souvenirs presque nostalgiques : lors d’une patrouille destinée à faire de la présence sur le terrain, aider la population, nous trouvons un beau buisson de figues de barbarie. Un moghazni, « vieux » et rude combattant, m’en offre une en l’ayant délicatement ouverte pour que je ne me pique pas les doigts. Lors d’une autre patrouille, nous dégageons une pierre sur laquelle je m’étais assis : c’était un chapiteau isolé – de quel monument, de quelle époque ? Je l’ai décrété punique et l’ai transporté dans le jardin de la baraque Fillod, où il doit encore se trouver, au cœur du village de Morsott.
Plus cocasse : un jour d’hiver, le grand vent des Aurès a emporté les parois des cabines de douche installées en plein air, laissant quelques militaires à poil, ensavonnés, frissonnants et hilares.
Oui, on était parfois en plein moyen âge : noblesse d’une population misérable, respect de l’ennemi désarmé, mais vengeances impitoyables, mutilations sexuelles révélatrices d’une société d’hommes obsédés et frustrés par la condamnation des femmes à l’enfermement ou au déshonneur. On faisait honneur à l’ennemi, au traître, en l’égorgeant, rituellement semblait-il, et on l’humiliait en l’abattant d’une balle dans la tête. De respectables vieillards drapés dans leur chèche parfois éblouissant et leur djellaba délavée et déchirée baisaient la main de l’Autorité, en l’occurrence le jeune sous-lieutenant de la SAS, en l’obligeant à les prendre sous sa protection par la formule rituelle d’allégeance : » Enta bouia, ou oueldik, tu es mon père et je suis ton fils « , donc » tu me dois ton aide « , tel le Grec antique embrassant les genoux de Zeus ou d’un prince homérique. Gêné, j’essayais de dérober ma main à ces « hommes liges », ou cherchant allégeance, mais ils me prenaient parfois par surprise.
Difficulté d’aider une population fataliste . A une demande d’intervention pour retrouver tel membre disparu d’une famille, je déclarais : » Je ferai tout ce que je pourrai, apportez-moi demain tel ou tel document « . Or demain, ou après-demain, redoua, oula bad redoua : l’avenir n’appartient qu’à Dieu. Le solliciteur, aussi motivé qu’il fût, répondait : » Inch’Allah, si Dieu veut « . Et quand une promesse était faite pour le lendemain, elle était livrée à l’incertitude totale de l’avenir …
Mais j ‘ai bénéficié d’un » demain » plus positif : lors d’un de mes intérims comme chef de SAS à Morsott, j’avais décidé d’aller » faire de la présence » sur le terrain, dans telle mechta isolée, le lendemain. Un vieux caporal, très décoré, respectueux mais obstiné, est venu me trouver seul à seul : » Pas demain, mon lieutenant, après-demain, bad redoua « . Donc il savait où se trouvaient les « fells » et pouvait sans doute les prévenir. Complicité des réseaux de population, des clans et tribus, correspondances complexes entre ceux qui étaient supplétifs » chez nous » et les rebelles. Preuve de confiance extraordinaire que m’a manifestée cet homme que j’aurais pu –ou dû ?- faire » interroger » par le 2éme bureau. Ai-je trahi l’Armée en me pliant aux conseils du caporal –en respectant les risques qu’il prenait ainsi ? Nous avons en tout cas évité assurément un accrochage sanglant : quelques morts de plus auraient-ils fait progresser la » pacification » ? Le respect, comme partout et toujours, est salvateur quand il est mutuel et j’ai sans doute dû cette confiance à mon intervention originelle – si naïve !
Morsott … mort sotte ? Hugo : » La mort stupide eut honte, et l’officier fit grâce « . Quelle mort, quel officier, quelle grâce ?
 Guentis : dérive d’une SAS vers le pire
Guentis : dérive d’une SAS vers le pire
En juillet 1960, j’ai été détaché de la SAS de Morsott et envoyé, comme chef de S.A.S. par intérim, à Guentis, à l’est de Tébessa, en plein massif des Aurès, où mon ami M. de R. était en poste après un autre sous-lieutenant appelé, G., qui y avait laissé le souvenir d’une brute ivrogne et tortionnaire. Ce poste isolé avait tellement mauvaise réputation que je n’ai pas dit à Jacqueline, partie accoucher en métropole, où j’étais nommé. Le climat d’horreur était dû aux souvenirs sanglants qu’y avaient laissés deux rébellions du contingent, très majoritairement composé de F.S.N.A., et les répressions impitoyables qui s’étaient ensuivies (Un témoin : » on en pendait partout, par le cou ou les pieds « ). Le commandement s’entêtait pourtant à envoyer sur ce piton des compagnies très majoritairement FSNA. M. de R. avait choisi ce poste par une sorte de romantisme, par défi -malgré son bon rang de sortie des EOR qui lui aurait permis de rester dans une grande ville- . Bon cavalier, il se distrayait de cette ambiance morbide en se livrant avec ses moghaznis à des fantasias échevelées, qui lui ont coûté deux blessures. Il était à l’hôpital en France quand je l’ai remplacé.
Je suis parti de Tébessa pour Guentis en avionnette. J’ai eu au décollage une pensée pour mon ami d’enfance Joël Milandre, le premier de notre génération dont nous avons appris la mort, aux commandes de son avion de chasse en Algérie : je m’étais fâché avec mon père, qui m’apprenait sa mort, en lui rétorquant avec ironie les arguments du Figaro » Mais non, voyons, on sait bien qu’il n’y a pas la guerre en Algérie, et bien moins de morts que sur les routes françaises ! « .
A Tebessa, il est excitant de monter dans l’étroit habitacle à ciel ouvert qui sert de siège pour le passager du petit piper-club, son mince bagage sur les genoux. Le sergent pilote est derrière moi. Ça pétarade, ça file comme une motocyclette à ailes, et nous volons au-dessus de la ville, dont on m’a dit un jour que, l’année de la répression, les rues charriaient du sang, cette même rue où j’ai fait faire mon képi bleu. (Je portais d’ordinaire soit un calot rouge sang soit, comme les moghaznis, une gurka , béret beige pâle dont la fente arrière était ornée de deux rubans, rouge et bleu ciel) . Les vagues de montagnes rocheuses et désertiques défilent au-dessous de nous. Nous ne sommes pas assez haut pour ne pas risquer quelque rafale hostile -me dit le pilote avec une évidente satisfaction- , mais les contacts radio nous rassurent : ce sont des postes invisibles qui saluent notre passage. Un premier survol de Guentis, le temps de laisser le berger chasser les chèvres qui arrachent quelques épines ou racines sur le terrain, puis nous nous posons en cahotant.
A la SAS, mitoyenne du poste d’infanterie, je trouve quatre bonshommes qui luttent contre la chaleur desséchante d’août, assis tout habillés dans une citerne, de l’eau jusqu’au dessus de la taille, jouant aux cartes. Ils se penchent pour tirer du fond, à leurs pieds, des bouteilles de bière. Ils m’en offrent, ainsi qu’une bonne omelette pour attendre le déjeuner. On mangeait assez bien à Guentis. Bien sûr Gral, l’attaché civil, ne fait pas partie des joueurs. Il y a un sergent brutal, efficace, méprisant, nourri de cette haine envieuse envers les officiers, surtout ceux du contingent, qu’ont beaucoup de ses congénères. Un vétérinaire peut-être, et en tout cas un médecin du contingent, qui s’amuse parfois à resculpter l’oreille de tel ou tel moghazni à sa demande.
Le plus atteint est le radio, un ex-légionnaire allemand, dont le toubib me montre le lit : rempli de femmes nues ou déshabillées découpées dans un magazine. Sa radio ne marche pas et l’Allemand a renoncé depuis longtemps à capter quoi que ce soit. Les Dragons voisins nous communiquent les urgences et l’ex-légionnaire peut se consacrer à la bière et à ses fantasmes érotiques, qu’il réalisera, nous dit-il sans épargner les détails, lors de la descente mensuelle, en GMC, à Tebessa.
A Tebessa il y a ce grand bordel, fréquenté essentiellement par les militaires, qui souvent ne font qu’y prendre un verre Ce grand bâtiment évidé, ou immeuble refermé sur une cour intérieure protégée par une verrière, était le principal but de promenade pour les permissionnaires de la région. Les militaires, avec quelques civils, s’asseyaient aux tables installées au rez-de-chaussée, et consommaient leurs boissons en regardant –il y avait peu de distractions dans cette vie-là- les consommateurs de filles qui montaient dans les étages par des escaliers et terrasses donnant sur l’espace intérieur . On n’y voyait pas de musulmans, eux dont la sexualité refoulée exacerbait la pudeur. Un sergent prenait le nom des soldats qui voulaient consommer, les examinait brièvement, leur remettait une serviette et un savon. Et « Au suivant ! » Mais le radio, dit-on, n’y est jamais entré, se contentant de tourner sans cesse autour du bâtiment, en cercles concentriques, toutes les heures de sa permission durant, et d’acheter à la hâte quelques magazines avant de reprendre le GMC du retour.
A Tebessa, comme dans toute la région, sans parler de la Madaure de Saint Augustin, il y a aussi de magnifiques ruines romaines, arc de triomphe, portes monumentales, bains, mosaïques. Il y a également un hôpital où les FSNA sont entassés à trois ou quatre par lit. Les FSE, eux, ont droit à un lit par personne.
Un de mes prédécesseurs à Guentis avait, dans le meilleur des cas, » disjoncté « . Bibliothécaire, père de famille, il était devenu, dans le contexte historique de ce poste dangereux, une sorte de satrape fou : le crâne rasé, moustache énorme, il s’amusait à passer ses propres hommes à la » gégène « , et à s’y faire passer aussi, pour en évaluer l’effet. Dès le matin un moghazni lui apportait au lit un quart de rouge et recevait en remerciement le quart vide sur la tête. On a un jour attrapé un » suspect » en bordure de zone interdite et ce chef de S.A.S. a passé des heures à » l’interroger » : il s’est soûlé toute la nuit, assis sur le suspect, qui est mort au petit matin étouffé sous ses grosses fesses. Ce fait d’armes lui a valu la croix de la valeur militaire. Histoire rapportée par les attachés FSE que j’ai trouvés à Guentis. C’est peut-être en pensant à lui que M. de R. écrira, des années plus tard, dans une postface au témoignage d’un officier méhariste appelé, que l’armée française avait en Algérie employé des méthodes nazies. R. est dans ce texte très lucide et catégorique sur les causes de la guerre, bien qu’il affirme par ailleurs que sans la trahison de De Gaulle, si nous étions restés dix ans de plus nous aurions construit une Algérie française prospère et juste. D’autres anciens SAS n’en démordent pas : » De Gaulle –ils disent « qui vous savez « – , « le plus grand félon de l’histoire de France, a vendu l’Algérie aux communistes contre le pétrole saharien « . On pouvait voir en I960 des bulldozers préparer le tracé des pipe-line le long de la ligne Challe, pourtant soumise souvent la nuit à des tirs de notre artillerie contre des incursions FLN venues de Tunisie.
Cette S.A.S. de Guentis était pour le moins pittoresque, les bâtiments mal protégés au nord, les mitrailleuses cadenassées dans la soute à munitions, les moghaznis assez dépenaillés et » suspects » eux aussi. Ayant demandé une patrouille de nuit avec les meilleurs soldats, pour faire un peu de présence sur le terrain, je me suis vu attribuer une douzaine de supplétifs » sans doute du FLN ou très sympathisants « , me dit l’attaché civil, la vraie tête de cette SAS. Peut-être un bizutage, une mise à l’épreuve ? La peur au ventre, je suis parti avec cette petite bande de guerriers, silencieux comme des chats dans la nuit. On n’entendait, tel un carillon qui réveillait tout un horizon de chiens hurleurs, que le cliquetis des boucles métalliques de mes rangers. Mais, livré à ces hommes, j’ai vite senti que je ne risquais rien –l’esprit médiéval !- et nous avons sans conviction monté une embuscade bidon. Le vrai risque était de rentrer au poste et d’être pris sous le feu de la mitrailleuse qui tirait parfois la nuit sur tout mouvement décelé. Cette nuit-là mon radio a pu les joindre et prévenir » Hibou bleu fixe » que » Hibou bleu cinq » revenait de patrouille. C’était le souvenir des deux précédentes rébellions qui créait cette méfiance et nous faisait cacher nos mitrailleuses, paradoxalement inutilisables donc: les sympathisants FLN n’avaient intérêt à déserter ou se rebeller que s’ils apportaient des armes lourdes à l’ennemi.
Le poste était tenu par la SAS et par une compagnie d’appelés, encore très majoritairement algériens musulmans, ce qui indignait le lieutenant d’active mon voisin de piton, malgré son amertume résignée à l’égard du commandement. Il affirmait que le colonel commandant le secteur ne venait jamais à Guentis, jugeant l’endroit « trop dangereux » . Les hommes étaient exaspérés, la bière et le gros rouge coulaient en abondance, et le premier dimanche après mon arrivée j’ai vu un jeune caporal crâneur et ivrogne chahuter avec une grenade dégoupillée à la main ; il a fini par la garder trop longtemps et l’explosion, que nous avons entendue, lui a arraché la main. D’autres soldats se baignaient, sous la protection d’une mitrailleuse, dans les rares flaques d’un oued qui coulait à nos pieds, entre ces montagnes basses et caillouteuses où, à perte de vue, on ne voyait pas une trace de verdure.
Un jeu avait consisté aussi, pour des artilleurs, à régler leurs tirs sur les belles ruines d’un arc de triomphe romain, dans ce pays desséché qui avait été le grenier à blé de Rome. Des mosaïques mises au jour par mon prédécesseur avaient dès la nuit suivante été martelées par la population locale parce qu’elles représentaient, entre autres, des visages humains. Traces de peuplement plus ou moins ancien : une immense citerne dégagée des sables, plus au sud-est, près de Bir el Ater. Et aussi, dans une patrouille, ou une balade, autour de Guentis, la découverte d’une immense escargotière des débuts de l’histoire, ou d’avant elle : qui, ou quoi, avait amassé sous cette falaise ces myriades de coquilles en ce tumulus énorme ?
Oui, on se baladait. Les sorties, escortes ou occupation du terrain, avaient quelque chose de puérilement excitant. Les moghaznis étaient de vrais centaures : pour rassembler les chevaux, l’un d’eux les effrayait et les autres les attrapaient, au détour d’un rocher, par la crinière, pour bondir sur leur dos et les cabrer en leur tirant la tête en arrière. Je chevauchais devant, étant le chef, sur la selle anglaise que ce rang m’imposait. J’avais, les premiers jours, demandé à un vieux caporal de me donner quelques rudiments d’équitation. Bien qu’un peu crasseux, ils étaient beaux, nous étions beaux ! dans nos uniformes sahariens : mais sur les cinquante moghaznis, seule une trentaine pouvait parader à peu près équipée. Un jour nous avons fait une charge à travers une plaine, déployés en éventail, arme pointée, visant un gourbi désert : s’il y avait eu là une mitrailleuse, cette tactique, qui n’était qu’un jeu irresponsable, ou une provocation, aurait été mortelle. Mais là aussi il devait y avoir contact et entente au moins tacite avec les rebelles pour qu’il n’y ait pas de dégâts tant que ce ne serait pas le jour … La charge des trente cavaliers, de front, au grand galop, rênes dans une main et fusil ou PM dans l’autre, absurdité militaire, nous nous faisions notre cinéma, pimenté par le risque ! Et un autre jour, au retour d’une surveillance de col où nous serions morts de soif sans l’eau trouble apportée dans une outre en peau de chèvre, cette cavalcade précipitée derrière moi, et un fouillis d’hommes et de chevaux qui tombent entremêlés. La bière glacée, au poste, dont j’avais rêvé des heures, m’a coupé en deux dès la première gorgée: j’ai dû m’asseoir et attendre que mon estomac puisse supporter le liquide.
Sur ce poste régnait un gentleman étrange au nom de légende bretonne, monsieur Gral. Il avait » fait » l’Indochine et regrettait ce temps, comme tous ces vétérans qui ne confiaient jamais exactement le pourquoi de ce regret et de ce nouveau choix ascétique ; car un piton pelé des Aurès, dominant quelques gourbis aux populations aussi terrifiées que misérables, n’offrait à l’évidence aucune distraction. Gral faisait passer chaque soir ou presque, sur la sono du poste, l’adagio d’Albinoni, que je ne connaissais pas, et qui m’emplissait, comme tous les autres, d’une étrange sérénité. Pourquoi était-il secrétaire civil de cette SAS, pourquoi avait-il quitté l’armée après le Viet-nam, avec un grade d’officier supposait-on ? On ne pouvait admettre que ce beau personnage eût quelque chose à se reprocher, mais peut-être, oui, une indiscipline, une rébellion justifiée … Les violons et l’orgue d’Albinoni saluaient le coucher du soleil sur le reg, sur ce poste un peu déglingué à la mémoire tragique, sur les moghaznis sceptiques, dépenaillés, qui méditaient leur désertion en guignant les mitrailleuses inutiles et enchaînées, sur mon beau képi bleu et ma cachabia de campagne ou ma djellabah d’apparat : je me consolais en me sentant me regarder comme un soldat de cinéma, dernier défenseur d’une cause désespérée telle que les aime l’imaginaire populaire français, ces glorieux vaincus de nos mythes fondateurs : Roland, Jeanne d’Arc, Cyrano de Bergerac, les Trois Mousquetaires, les Grognards à Waterloo, les Légionnaires à Cameron ou dans tel bastion saharien … Hélas, impossible de croire que cette cause que nous devions défendre fût juste.
Et venait la nuit avec ses peurs, l’odeur aigre de mon bracelet-montre au cuir pénétré de sueur, le PM sur la table de chevet, parfois le fracas assourdissant de la mitrailleuse lourde de la compagnie voisine. Comme les gendarmes de Morsott, mais sans se contenter d’allonger quelques gifles, les officiers et sous-officiers du poste militaire se permettaient d’ » interroger » les moghaznis qu’ils trouvaient suspects, ordre du colonel SAS de Tebessa.
Pour jouer le jeu de l’héroïsme infantile, j’ai accepté d’aller par la piste, avec mon voisin le lieutenant commandant le poste, de Guentis à Tebessa, première agglomération à quelques heures de route. Il mettait son point d’honneur à passer en tête du convoi avec la Jeep, moi assis à côté de lui bien sûr. L’auto-chenille et le GMC nous suivaient. Ce jour-là, l’auto-chenille a sauté sur une mine, que les roues de la jeep avaient dû frôler. Les soldats ont été secoués, mais la lourde machine blindée n’a eu qu’une chenille arrachée. La jeep aurait été expédiée ad patres avec nous. Quelques jours plus tard un tracteur a sauté, son conducteur a eu le dos déchiré. J’en ai voulu à ce lieutenant dont l’héroïsme suicidaire n’était pas le mien : ma femme était en train d’accoucher en métropole, je vivais paradoxalement un bonheur paisible avec elle et bientôt notre petite fille dans l’enclave protégée de Morsott..
Je retrouve un récit que j’avais fait d’une opération lors de mon séjour à Guentis ; aucun détail, aussi sordide ou romantique soit-il, n’y est inventé, tout est dû à des témoignages indubitables hélas . Il s’agissait de sécuriser un col :
Les camions doivent repasser dans une heure. Pas question d’aller voir ce qu’ils deviennent. Rester groupés, on n’est déjà pas nombreux. Pourtant l’Aspirant s’interroge vaguement sur l’existence des rebelles. Seuls indices certains: des signaux lumineux la nuit au pied du piton où est installé le poste. C’est donc pour des complices dans le maghzen? On l’a prévenu à Tebessa : » Tous suspects. Cinq ou six sont prêts à déserter. Les gendarmes s’en occupent « . Sa lâcheté a accepté cette sollicitude des gendarmes qui se vantaient d’avoir amélioré l’interrogatoire par l’eau en y ajoutant de la lessive : ça faisait des bulles. Tordant.
A Guentis, il fait 40° même la nuit. Nuits d’angoisses fétides. Le Sous-Lieutenant précédent, dit-on, jouait à la torture avec ses moghaznis : à qui tiendrait le mieux sous la gégène , la génératrice électrique, nerf de cette guerre d’hommes à bout de nerfs.
Mais les rebelles existent-ils, dans ce nouveau Désert des Tartares ? Ou n’étaient-ils qu’un prétexte pour laisser en friche les vestiges d’horticulture aux bords de l’oued ? Vu d’avion, c’était sinistre, ces grandes lettres blanches sur quelques hangars, GUENTIS , dans un désert gris, caillouteux, escarpé, à perte de vue. Pas un seul arbre.
On pouvait faire semblant de jouer au volley-ball, quand un pan d’ombre à flanc de piton rendait la poussière plus supportable. On s’était même baignés un dimanche, trois brasses sous la protection d’un fusil-mitrailleur. Mais les rebelles ? Une nuit, la mitrailleuse lourde des Dragons avait tiré. Sur quoi ? Mais au fond on pouvait vivre, le cuisinier se débrouillait très bien avec ce que l’avion ou l’hélicoptère » banane » de Tebessa parachutait, un méchoui de temps en temps, et un vin épais, d’Algérie sans doute, à volonté.
L’allure de ces hommes à cheval, leur selle arabe, leur gandoura, leur turban blanc, cela fera de belles images dans les souvenirs, pense l’Aspirant. Pour l’instant la désolation l’emporte. La seule fraîcheur, l’oued mince entre deux rochers, a été irrémédiablement tachée par le sang d’un jeune soldat, un jeune con qui, par crânerie d’ivrogne, avait gardé trop longtemps une grenade dégoupillée dans sa main.
Le sang seyait à cette terre, où il devenait aussitôt gris–noir, où des cadavres pouvaient pourrir dans une lourde puanteur sans que jamais le sol reverdisse. Était-ce une signature des rebelles, cet égorgé gisant sur le bas-côté d’une piste, fendu d’une épaule à l’autre, avec cet étalage étrange de viscères entre le menton et le torse ?
Un médecin Aspirant avait trouvé sur ce piton un certain épanouissement pour ses blagues de carabin : il avait servi à table le plasma d’un accouchement récent et une autre fois, entre deux tranches de pain la main coupée d’un suspect exécuté ; c’était plus vite fait pour récupérer les menottes.
Les gendarmes aussi sont des hommes: le brigadier avait séduit une rebelle qui l’avait mené jusqu’à la grotte où se cachait son ancien amant du FLN ; elle s’était fait tuer en indiquant d’un geste d’où partait la rafale. L’Aspirant pense à l’émancipation des femmes algériennes par la guerre. Dans le djebel, elles portent comme les hommes pistolet-mitrailleur, treillis kaki et pataugas. Cela n’excluait pas le romantisme.
L’histoire qui faisait le tour des régiments : lors d’un ratissage en zone interdite, on avait amené un suspect à un jeune sous-lieutenant nerveux posté sur un piton. Il avait appelé le capitaine par walky-talky : » Que faut-il en faire, mon Capitaine ? –Descendez-le ! –A vos ordres, mon capitaine ! » Une rafale définitive avait scellé le malentendu.
Comme dans un rêve, j’ai vu aussi passer au pied du piton de Guentis une caravane de nomades, ces Hommes qui marchent selon le titre du beau livre de Malika Mokkedem. Où allaient-ils, dans ce pays en guerre, dans lequel la vie humaine, si elle était incarnée par un FSNA, toujours suspect d’être rebelle ou complice, ne valait pas cher ? Troupeau de dromadaires, de chèvres et de mouton, des hommes à pied, d’autres sur le cul des bourricots, et ce miracle : une nacelle blanche sur une chamelle blanche. C’est en accompagnant ces nomades qu’a été tué un lieutenant médecin de Guentis. Michel de R. ne s’est pas pardonné de l’avoir laissé partir pour cette mission qu’on savait dangereuse. Pas chère non plus, la vie d’un médecin.
Longue procession de nomades, une transhumance qui sans doute pour des motifs de tradition et de survie économique avait été exceptionnellement autorisée dans ces zones interdites. Balançant avec une lenteur majestueuse son énorme nacelle, la chamelle blanche transportait, disait-on, la fiancée d’un chef chaouia, cachée derrière cette fragile et élégante structure de bois et de voiles. La belle ne devait pas se montrer, parce que « l‘achaaba » traversait des villages de sédentaires, où les femmes mènent une vie larvaire dans les recoins les plus sombres des mechtas, interdites de soleil et d’espaces libres, blafardes génitrices engrossées tous les onze mois, des vieillardes à vingt-cinq ans, qu’on peut répudier si elles n’ont pas donné assez d’enfants mâles ou n’entretiennent pas bien leur domaine d’ombres recluses. En revanche dans le désert on pouvait apercevoir des femmes chaouia, à l’ombre presque fraîche d’une khaïma, le visage sans voile, belles et dignes . On rêve alors à ces cours d’amour des Touaregs sur lesquelles régnaient des femmes.
Mais comme rien n’est simple, on apprend que cette forme voilée qui trottine derrière son mari confortablement installé sur son âne subirait un affront si, selon la galanterie européenne, on lui donnait la place de l’homme: par respect envers la femme, elle ne peut monter qu’une bête femelle, blanche de préférence. Ce sont les Arabes qui, lors des Croisades, ont enseigné l’art de vivre dans le raffinement aux Européens grossiers, ce qui a permis à ceux-ci d’inventer, entre autres, l’amour courtois. Femme musulmane: « maltraitée » parce que trop vénérée ? Mais parfois toute-puissante dans son domaine, dans la maison, pour ses enfants, alors que l’homme peut apparaître comme un fainéant qui traîne son ennui en jouant aux dames ou se livrant à de vagues méditations sur la fatalité : ce que décrit l’écrivain marocain Driss Chraïbi.
Retour à Morsott après Guentis : service scolaire, service médical, service aux femmes
Les femmes algériennes: ces combattantes du FLN qui » crapahutaient » comme les hommes dans les djebels , en treillis militaire et pataugas, forçant l’admiration de nos commandos Challe, – » ils font jusqu’à 60 km par jour ! » – seront après l’indépendance le plus souvent ramenées à l’enfermement et au voile. On a parlé d’une épidémie de suicides chez les lycéennes musulmanes d’Alger à la même époque … Quant aux Pataugas, on disait que le fabricant français en avait vendu autant au FLN qu’à l’armée française… Et que le » 105 sans recul » français avait été acheté et utilisé par le FLN avant que l’armée française l’ait reçu.
Bien sûr, les éléments de civilisation moderne que la France a apportés, quoique très rudimentaires et en retard sur la métropole (à l’hôpital de Tebessa, un lit pour quatre FSNA, mais pour un seul FSE[2]) : les gares, les préfectures, la santé et l’éducation (mais pour seulement 10 à 20% des jeunes Algériens !). On dirait un peu, avant la lettre, la propagande castriste. Or à ce moment-là, dans les Aurès, à qui ne paraissait-elle pas sympathique, cette révolution des Barbudos cubains, avec leur humour, leur musique, leur humanité ; mais nous ne savions pas que nous aurions pu croiser le Che dans les rues d’Alger, et peut-être sympathiser avec ce Che christique des Carnets de route , et certes pas avec le sanguinaire Saint-Just de La Havane.
Dans l’est algérien, nous aussi nous scolarisions : à Morsott, ma femme était une des rares institutrices bachelières, dans une école toute neuve , où venaient des enfants de tout âge, leur formation étant des plus irrégulière selon les années et les déplacements de la population, chassée des » zones interdites » et regroupée dans des camps comme celui d’Ouenza et Bou Khadra. Dans la même classe donc pouvaient se trouver des enfants de 6 et de 14 ans. Dans l’école de Morsott, Jacqueline n’oubliera jamais l’enthousiasme, la gentillesse, la générosité de ses élèves, qui nous comblaient de pâtisseries orientales mielleuses et rances, et pleuraient de terreur quand elle leur a dit qu’elle repartait en métropole sur la mer, toute cette eau inconnue et antinomique de leurs Aurès. Ils allaient et venaient librement chez nous, dans notre baraque Fillod, sans que quoi que ce soit ait jamais disparu. J’ai prêté cette maison pendant une permission à un lieutenant méfiant, qui fermait les serrures à double tour : on lui a volé presque tout son linge. C’était comme cette embuscade où j’étais parti avec les plus suspects : en réalité on m’avait confié à eux, selon un certain code d’honneur tacite. Quel vieux misérable n’imposait pas la dignité de sa prestance, dans sa djellaba déchirée et sous son chèche douteux, mais soigneusement et longuement enroulé ?
Oui, Jacqueline me donnait du courage. Avec elle, puis avec la toute petite Dominique a protéger, je n’avais plus le droit d’avoir peur. Ma femme était intrépide – peut-être parce qu’elle avait vu à huit ans son père échapper aux rafales des miliciens venus l’arrêter et ses frères, Résistants eux aussi, prendre tous les risques dans leur adolescence – et avait fait de notre maison un havre de paix où j’évitais autant que possible l’intrusion des horreurs de la guerre. Je la protégeais : comme ce jour où, armé de mon vieux pistolet de poche, j’ai poursuivi un gros serpent venu se glisser derrière la gazinière !
Avec le salaire des ouvriers mineurs de ces deux gisements de fer -Ouenza et Bou Khadra -, plus la modeste solde des supplétifs, harkis et moghaznis, les gens trouvaient de quoi ne pas mourir trop vite de faim sur cette terre déshéritée. A la SAS de Morsott, des logements corrects avaient même été construits pour les moghaznis et leur famille. Faisant une tournée d’inspection, j’essayais d’éviter le plus possible le gras parfum dont la femme du moghazni m’aspergeait quand je franchissais la porte. Les FSNA intéressés ont bien pris cette inspection, destinée à leur assurer un logement correctement entretenu, alors que les FSE, dont mon capitaine, ont fait les gorges chaudes de ma politesse : candide provocateur, je disais « Madame » aux » Fatmas » !
Noblesse du dénuement, un jour muée par miracle en richesse spectaculaire : une foire aux chevaux, ou une période de remonte ? Dans Morsott caracolaient des bêtes de feu, nerveuses et splendides, maquillées au henné et portant sur leur » robe » des dessins multicolores. Un étalon saillait plusieurs juments par jour, aux soins d’un palefrenier FSE râleur, furieux de jouer son rôle en public et de subir les grasses plaisanteries qui devaient être son lot à longueur de vie. Mais où les gens cachaient-ils leurs pur-sang en temps ordinaire, de crainte de se les faire réquisitionner par l’armée ou les fellaghas ? Dans le fond d’un oued, un jour, nous avons vu les traces de sabots qui avaient permis à un rebelle de nous échapper …
Beauté, noblesse, richesse, paradoxes de ces pauvres parmi les pauvres : il y avait les villageois, aux femmes cloîtrées, lamentables êtres blêmis par l’ombre de leur geôle, ne sortant qu’avec un voile total qui n’était transparent que pour elles, de l’intérieur, livides pondeuses d’enfants quasi végétatives au fond des gourbis. Seule occasion de sortie, la visite médicale leur était autorisée par leur mari, en groupe, et le toubib se trouvait devant des croupes aussi dénudées que le visage restait caché, entendant des voix exiger » la piqûre « , la médication magique. Mais il y avait aussi, étaient-ce les Chaouïas ?- des nomades, au statut improbable et combien fragile en ces temps d’une guerre appelée » maintien de l’ordre « . Un matin je suis tombé dans le bled sur une grande khaïma, tente au beau tissu épais en poil de chèvre et de chameau, avec de sobres rayures de couleur. Une toute jeune fille nous a regardés sans peur ni mépris, sereine, de ses yeux noirs agrandis par le khol. Elle était très belle, assise en tailleur, seule en apparence, parée de ses lourds bijoux berbères , argent, ambre et turquoise. Ce pouvait être la paix, le bien-être, le bonheur sous cette grande tente aux bords relevés qui donnait le maximum d’ombre et de ventilation au milieu de cette plaine écrasée de soleil …
Le toubib de Morsott était l’aspirant Mondine-Pécarère du 26ème I, dévoué, courageux (appelé souvent en plein baroud lors d’un accrochage), condamné, comme ses semblables, à rester aspirant à la solde misérable pendant tout son service : j’ai cru comprendre que l’Armée, par souci d’économie ?, recrutait les médecins avant leur thèse de doctorat, ce qui leur interdisait de devenir sous-lieutenants, alors que les dentistes et vétérinaires obtenaient vite leurs deux galons, pour des missions autrement tranquilles ! Toubib ou toubab , les voyelles sont mal déterminées pour une oreille étrangère, comme pour la formule si courante et hélas si révélatrice de nos rapports avec la population : » n’aie pas peur ! » : » ma tekhfech « , » ma tekhefouch », entendu « ma tarfouch » ou » ma terfich » . Puis, plus agressif » hak el hakk, guidguid « , » Dis la vérité, exactement ! » … Aussi révélateur (et définitif ?), le succès du dernier conseil de révision à Morsott en 1960 : sur 70 appelés, une dizaine de présents, dont deux ou trois encore s’évanouiront dans la nature avant d’être incorporés dans l’Armée française. Les jeunes avaient voté d’abord avec leurs pieds, donc déserté selon le règlement militaire.
Mariée à douze ans, vieille après trois ou quatre maternités à vingt-cinq, les femmes et leur dot étaient renégociées et l’homme achetait une nouvelle femme s’il en avait les moyens : la polygamie était non pas simultanée mais successive. Ces exemples me font mieux comprendre Malika Mokkedem, et Germaine Tillion, ( sans oublier Isabelle Eberhardt partant en opération, sous l’apparence d’un jeune goumier, contre les rebelles algériens… en 1900 !) , qui soulignent l’importance fondamentale des notions d’intérieur et d’extérieur dans la culture arabe, avec ses conséquences sur la condition des femmes, la frustration exaspérée des femmes et aussi des hommes. Terrible condition féminine définie par le Harem, le Sacré mais surtout l’Interdit, au point qu’une femme hors de chez elle, une femme chez quelqu’un d’autre ne s’appartient plus, elle est au maître des lieux. Les Hommes qui marchent de Malika Mokkedem m’en ont fait prendre mieux conscience, des années plus tard, tout en me renvoyant l’image, sans manichéisme, qu’une petite Algérienne de douze ans pouvait avoir des militaires français durant cette guerre.
En I960, on a créé à Morsott un foyer féminin où les femmes du secteur devaient se réunir tous les samedis, dans la louable, naïve et tardive intention de les aider à s’émanciper. Aucune volontaire ne s’étant présentée le premier samedi, les supplétifs, harkis et moghaznis, reçurent l’ordre d’y faire venir leurs épouses. Les deux ou trois samedis suivants, on vit des supplétifs raidis de honte se diriger vers le foyer, suivis à quelques pas par un fantôme intégralement voilé. Il en vint deux fois moins le troisième samedi, on abandonna l’idée.
Dominique est née, je suis allé en permission à Valence et Tournon, Jacqueline est revenue à Morsott, que j’avais regagné après l’intérim à Guentis, avec le bébé dans les bras. Ravi d’avoir une si jolie petite fille, j’étais surpris par l’insistance à me consoler que mettaient mes amis FSNA : » Ne vous faites pas de souci, le prochain sera un garçon ! » … Nous avons fait pousser du gazon et des radis dans la cour de notre baraque Fillod, c’était l’automne, nous étions bien, Dominique prenait le sein, nous jouions au bridge, aux boules avec les camarades du mess, nous avions même un rudimentaire terrain de tennis. Parfois un méchoui à la SAS où les officiers avaient droit aux fins morceaux de l’échine et où des indigènes affamés mangeaient leur ration de viande de l’année. Audacieuse, Jacqueline s’exerçait, quand nous essayions des armes tchèques trouvées dans des caches, au P.A et même au P.M., où elle surpassait bien des officiers. Des cavaliers sémillants puis des légionnaires peu disciplinés avaient remplacé les fantassins du colonel Kretz. Les cavaliers – qui n’étaient jamais montés à cheval, j’étais fier de mon escadron de voltigeurs à Guentis – croyaient surprendre les rebelles en partant le soir dans leurs engins pétaradants, qui s’entendaient jusque dans les montagnes où les Fells avaient enfin le temps de terminer leur couscous. Quelques mois auparavant, plus » cavalier « , mais fin caricaturiste, un capitaine, voyant Jacqueline lutter contre le vent pour rejoindre le mess, son ample robe de grossesse collée au corps, m’avait dit qu’elle arrivait » ventre à terre « . Voici le souvenir qu’elle a gardé de notre vie à Morsott, et de son travail d’institutrice (paru, avec quelques lignes censurées ! , dans le bulletin des SAS n°10 de décembre 98):
C’était une classe mixte, à l’école de Morsott au sud de Bône, sur la route qui mène à Tebessa. Jeune institutrice, jeune mariée j’avais voulu suivre mon sous-lieutenant de mari envoyé en Algérie, comme bien d’autres en 1959. J’avais donc obtenu facilement ma nomination dans cette école de village où le sous-lieutenant était l’adjoint du capitaine de la S.A.S. Là, j’ai tout de suite tout aimé, et surtout mes nouveaux élèves, âgés de neuf à quatorze ans. La scolarisation menée parfois à la hâte se réalisait dans l’improvisation, on était de bonne volonté, mais rien n’était facile.
Ces enfants ont vite appris à chanter tôt le matin, dès la rentrée des classes, tout un répertoire de chansons françaises héritées de mes jeunes années, encore proches. Je les revois, debout devant leur pupitre, le buste droit, attentifs à mes gestes et chantant à pleins poumons « Salut glaciers sublimes, vous qui touchez aux cieux … » et bien d’autres airs où il était question de France profonde, de mer, d’alpages, des airs folkloriques enfin. Ils ne connaissaient pas ? Ça ne leur évoquait rien du tout ? Et alors ? Qu’on se rassure : à l’époque ils étaient légion les enfants des « bleds » les plus reculés de France qui n’étaient jamais sortis de chez eux, et auxquels on enseignait une autre réalité géographique. Eux, c’était pareil. Les autres classes de l’école appréciaient – paraît-il – , c’était une mise en train générale que ce quart d’heure « musical ».
Les rapports avec ces enfants étaient heureux, nous nous comprenions, la confiance régnait, jusqu’au jour où un vol eut lieu. Une trousse, un stylo ? Je ne sais plus exactement. Chaparder est quasiment inévitable pour des enfants démunis de presque tout, chez qui la convoitise de l’objet cher, donc rare, est compréhensible. Lamentations, pleurs, suspicions s’ensuivirent. J’ai donc exigé réparation : j’ai demandé que ledit objet soit restitué le lendemain même. J’ai bien précisé que je ne voulais rien savoir, ni de l’auteur, ni des circonstances du larcin. Le lendemain le stylo -ou la trousse- trônait sur mon bureau, et était rendu à son propriétaire. Le calme était revenu, le rythme scolaire quotidien se poursuivait.
J’avais droit dans ce village à un « logement de fonction » qui était une baraque Fillod en tôle où mon mari et moi logions. Un gros poêle y ronflait en cet hiver humide de 59 et nous avions rendu cet habitacle aussi gai et chaleureux que possible. Mes élèves, surtout les fillettes, y venaient, entraient et sortaient au gré de leur fantaisie, heureuses de préparer avec moi la venue d’un enfant que j’attendais. Les garçons venaient parfois, plus timides, les bras chargés de galettes et gâteaux au miel, confectionnés par leur mère ou leurs sœurs. Puis cette baraque fut prêtée à un ami officier lors de la visite de sa femme et d’un voyage en métropole de notre part, permission et vacances scolaires. Quelques objets disparurent, mais curieusement rien qui nous appartînt. Notre ami, soupçonneux a priori, s’était soigneusement barricadé et les autres avaient donné l’assaut. Les enfants le considéraient-ils comme un intrus? En étaient-ils jaloux ? On ne l’a jamais su mais l’histoire nous fit quand même sourire.
Ces enfants, j’ai dû les abandonner un soir de novembre, je crois, à la libération de mon mari. Nous sommes partis de Morsott par le train, heureux tellement heureux bien sûr, mais avec beaucoup d’émotion. A la gare du bourg des amis, des élèves, et surtout Ali dont je garde la dernière image. Appuyé contre un mur, il dansait d’un pied sur l’autre, agitait sa main et pleurait. Ali, le plus pauvre parmi les pauvres, que j’ai toujours cru être l’auteur du chapardage, et qui redoutait tant pour moi ce retour en France : « La mer, c’est grand, on ne peut pas la traverser, vous allez mourir noyée … »
Après l’Algérie, un bref retour en France, puis nous fûmes nommés au Mexique. Là, un autre langage, une autre vie. Chez mes nouveaux élèves il n’était question que d’Acapulco, de mer, de cheval, de piscine. Ces enfants de différentes nationalités fréquentaient le lycée franco-mexicain et avaient, tant mieux pour eux, une enfance choyée. Au début ils ne m’inspirèrent, à tort bien évidemment, que peu de sympathie. Mais la blessure presque physique que m’avait laissée une courte parenthèse de ma vie dans ce village algérien était encore trop sensible pour être refoulée dans le passé. C’était trop injuste : ces enfants si différents avaient le même appétit de vivre, de vivre une enfance heureuse, et les uns y étaient plus aidés que les autres, c’était leur seule -mais combien grande !- divergence. Jacqueline Bibard.
Les légionnaires brutalisaient la population et élevaient une colline de bouteilles de bières vides, qui doit encore se trouver non loin de Morsott. On disait que les légionnaires allemands disciplinés comme de bons SS qu’ils étaient souvent, décimés en Indochine, avaient été remplacés par trop de voyous, qu’on ne pouvait hélas plus envoyer » faire la pelote » à Tataouine » les deux ombrelles « . Jusqu’à la seconde guerre mondiale, la » pelote » consistait, dans la fournaise de Tataouine, à faire tourner jusqu’à l’évanouissement les soldats indisciplinés, chargé de sacs remplis de pierres. Rien n’avait semble-t-il remplacé cette incitation à la discipline dans ce régiment qui eut vite fait d’annuler tous les efforts de pacification des deux précédents. On était loin du triomphe populaire dont se vantait un capitaine à propos du référendum de 1958 : les villageois de Morsott et des environs avaient voté à 108% » pour De Gaulle » ! On sait en outre que les bulletins » non » étaient violets, couleur maléfique pour eux…
Nous étions amis avec le chef de gare de la SNCFA (A pour Algérie), Monsieur Mokrani et sa famille. Ses enfants étaient de très bons élèves de Jacqueline. Nous nous entendions à demi-mots sur la guerre et l’avenir probable de l’Algérie. En 1962, il a répondu à mes félicitations pour leur Indépendance, envoyées du Mexique, dans une lettre aussi pleine d’espoir que d’appréhension -mais en m’assurant que « même sous l’uniforme » je n’avais -nous n’avions- laissé que des amis à Morsott. Même le maire Z., grand profiteur de la collaboration avec nous – sans cacher à tous son mépris » La SAS elle est sous mes couilles » se laissait-il aller à confier à ses administrés – , hautain envers les instituteurs qui essayaient de discipliner ses enfants gâtés, très mauvais élèves, s’était arrangé pour ménager son avenir avec le FLN, toujours aux dépens des petites gens, en l’absence des meilleurs parmi les combattants FLN, tués au combat comme le lieutenant Mohammed ben Youssef Sidi Yahia .
Nous avons retrouvé, par l’association des SAS, un ancien moghazni qui était alors le plus jeune et bagarreur de la SAS, dix-huit ans, Allaoua Rebaï. Avec une intelligence et une énergie hors du commun, il tire sa famille du camp de Rivesaltes après leur départ risqué d’Algérie, épouse une » Française » (comme s’il ne l’était pas lui-même, avec en outre un grand-père enterré à Verdun !), devient entrepreneur et président de l’ANASRA, association d’ex-supplétifs, membre d’une commission interministérielle, à tu et à toi avec célébrités et ministres, légion d’honneur…
Plus le temps passait, plus l’audace fléchissait, plus on comptait les jours qui restaient pour » s’en tirer « , » la quille, bon dieu ! « . On disait, ce qui pouvait rendre discret, qu’un prestigieux capitaine SAS, qui avait heurté des intérêts socio-économiques trop puissants dans cet est algérien, avait été tué dans une embuscade par » les nôtres « , mais avec des armes tchèques récupérées sur des rebelles, pour détourner les soupçons. Nous savions qu’il avait eu des bonnes idées, comme celle de replanter des oliviers dans un désert ayant gardé depuis des siècles le nom de Zitouna, l’oliveraie, qui a donné l’aceituna espagnole, comme la Halloufa portait le nom des » porcs « , les sangliers qui l’avaient peuplée. Mais son réformisme ne plaisait pas à tout le monde.
El Ma el Abiod, autre SAS au bord de la ligne Challe
Je croyais « tirer » les derniers mois dans la quiétude relative de Morsott. Mais dès le retour de Jacqueline et de Dominique j’ai été envoyé, pour un nouvel intérim, à El Ma el Abiod (« L’Eau blanche »), au sud de Tebessa. » Quelle aventure ! « , s’est exclamé, en apprenant ma situation, le sous-lieutenant que je remplaçais. Nous avons quitté le capitaine, que je n’aimais guère pour son immobilisme administratif, de la SAS de Morsott, et sommes allés à Tebessa prendre la jeep pour El Ma el Abiod. Devant, le conducteur et moi, derrière, un moghazni bien armé et Jacqueline avec le bébé. A nouveau le regard scrutant les abords de la route, supputant les risques d’embuscade, comme lors du voyage de Bône (aujourd’hui Annaba) à Morsott, que nous avions terminé, malgré les mises en garde, après le couvre-feu.
La nouvelle SAS se trouve sur un piton, voisine d’une unité de cavalerie et d’une batterie de canons surveillant la ligne Challe, barbelés et champs de mines qui nous protègent des incursions depuis la Tunisie toute proche. Dès les premières nuits, nous sommes réveillés par un bombardement ; vite, nous savons que ce sont nos canons qui tirent sur la ligne où un mouvement a été détecté. Un caporal frappe à ma fenêtre et me demande de sortir. Je suis seul avec Jacqueline et Dominique. Je lui réponds de s’adresser au sergent-chef, l’intermédiaire hiérarchique entre moi et le mokkadem, chef FSNA du maghzen. Bizarrement, le lendemain matin, aucun souvenir de cet incident chez personne. 50 ans plus tard, je rencontre par hasard le colonel Paolo et nous découvrons que cette nuit-là c’est lui, jeune lieutenant artilleur, qui nous avait réveillés en ordonnant le tir à sa batterie.
Mon mokkadem, quand je suis parti, m’a offert un cadeau inestimable : une petite lampe à huile romaine … Qu’est devenu cet homme ? Je ne me rappelle pas son nom. Le sable avait envahi toute cette région des Aurès, ancien « grenier à blé » de Rome, et l’on découvrait ici et là des vestiges de la splendeur climatique passée: au sud cette énorme citerne-piscine de Bir el Ater, « le Puits noir » (du pétrole?) , et à l’ouest les mosaïques de Guentis, non loin du bel arc de triomphe massacré par nos artilleurs comme les mosaïques l’étaient par la superstition des populations locales, effrayées de voir apparaître des visages humains, que les fouilles avaient dégagés sous les alluvions qui les avaient protégés, des siècles durant, contre les interdictions islamiques.
Le jeune mokkadem, avait été témoin et exécutant discipliné de la répression ordonnée par mon pénultième prédécesseur pour « faire parler » les membres du conseil municipal. Il s’est, par son obéissance à son officier français, sans doute condamné à mort pour le jour de l’indépendance. Les nostalgiques de l’Algérie française qui versent aujourd’hui des larmes de crocodile sur le sort tragique des harkis sont souvent les mêmes qui par leurs ordres en faisaient des tortionnaires et des assassins. J’ai essayé en novembre 1960 de prévenir ces moghaznis plus dévoués qu’opportunistes, et certes pas « collabos » (quel collabo français avait la tombe de son grand-père dans un cimetière militaire allemand de 14-18, comme l’avaient à Verdun nombre de ces vétérans ?) : avec un petit discours, dans mon arabe indigent, je leur ai vanté la grandeur de De Gaulle « en France et en Algérie », défiant le tabou de l’ » Algérie française » . Je crois pouvoir dire que les moghaznis qui ont été sous mes ordres et ceux du capitaine Pichereau à Morsott n’ont pas maltraité la population et ont sans doute été épargnés lors de l’indépendance.
Algérie française. On avait inventé celle-ci en désespoir de cause, sous la pression de la guerre, croyant ainsi réparer et effacer les décennies de répression, d’injustice et de misère subies par ceux qu’on affectait de vouloir enfin considérer comme des hommes « à part entière », expression popularisée alors par De Gaulle je crois. Les partisans de l’ « Algérie française » évitaient tout de même de dire « les Algériens français » ! Des parents pieds-noirs nous avaient déclaré « Mais vous savez qu’ils relèvent la tête maintenant ! » . C’était si bon, aussi médiocre qu’on pût être, de passer majestueusement au milieu de têtes courbées ! Mais ils disaient aussi : » Quel merveilleux pays, s’il n’y avait pas ces Arabes ! » Et des radicaux simplistes affirmaient qu’on règlerait vite le problème si chaque FSE tuait dix FSNA! L’ennui, c’est que l’histoire de ces guerriers farouches et toujours plus ou moins insoumis rendait la chose improbable, bien que le macabre bilan de cette guerre soit vraisemblablement de plus de dix tués pour un …
Le mokkadem, guerrier sans doute impitoyable, m’a donc un jour, sans un mot, offert ce qu’il avait trouvé dans le désert : une très fine et rare lampe à huile romaine, représentant une Diane chevauchant un cerf. La lampe était encore pleine de sable. Un jour à Mexico, nous l’avons cassée en l’époussetant. Ma peine de cette maladresse s’est atténuée quand j’ai pu en recoller les morceaux. A cet homme j’avais dit un jour : « Quand on va dans le bled, on ne prend pas une poule aux paysans, on ne leur prend même pas un œuf ». Il m’avait répondu : « A vos ordres mon lieutenant! » et avait obéi, comme il avait sans hésitation obéi à un autre sous-lieutenant, un ou deux ans plus tôt, en torturant ou égorgeant ceux qu’on lui désignait. Je crois avoir compris que mon pré-prédécesseur à El Ma el Abiod désirait ainsi faire admirer sa virilité aux officiers du régiment voisin de cavalerie : faudrait pas prendre les SAS pour des mauviettes ! Ce mokkadem et les autres moghaznis ont-ils échappé à la vengeance en 1962?
Nous avions dû un jour aller à Tebessa remplir des formalités administratives, soit à l’inspection académique pour Jacqueline, soit auprès du Colonel SAS pour moi. Notre fille avait tété et nous pensions qu’elle dormirait jusqu’à notre retour. En rentrant au bordj, nous avons vu le vieux caporal qui montait la garde assis, son P.M. sur les cuisses, berçant de sa main libre le landau de Dominique. Image inoubliable: dans la blancheur éclatante de cette terrasse – d’où l’on pouvait surveiller la plaine jusqu’à la lointaine frontière tunisienne – , le bébé, la paix, la tendresse, et le sombre guerrier en treillis kaki coiffé de sa gurka. Cet homme rude portait ses décorations des campagnes d’Allemagne et d’Indochine, et il avait sans doute obéi « sans hésitation ni murmure » quand l’autre officier lui avait fait battre, électrocuter, mutiler ou égorger les membres du conseil municipal suspects de sympathie pour le FLN. L’officier français est rentré en métropole parader avec sa croix de la Valeur militaire, et le vétéran a dû se faire égorger à son tour.
En me passant les consignes pour cette SAS, mon prédécesseur immédiat, un élégant dilettante, m’avait dit qu’on devait regagner la confiance des membres survivants du conseil municipal, me laissant entendre à quelles horreurs on les avait soumis. Des détails, par bribes, me furent racontés plus tard. Il avait également effaré ma naïveté en me déclarant « qu’il n’y avait plus rien dans la caisse noire ». Qu’est-ce que c’était qu’une caisse noire ? Je fus mis un peu plus au courant des problèmes de gestion par l’attaché civil, qui se protégeait par un détachement cynique de cet environnement mortifère. Je trouvai dans un tiroir de mon bureau un bon nombre d’enveloppes non décachetées, dont il me dit que c’étaient des factures. A Tebessa le colonel me demanda de signer une décharge pour toutes ces sommes. J’acceptai de le faire dès réception de son ordre écrit. Il m’ordonna de m’exécuter sur-le-champ. Complètement imbécile, je m’en tins à la demande d’une lettre. Il écumait. Je me retirai en l’assurant de mes respects, mais seulement au pluriel, comme dans l’armée.
Dans mon rapport d’activités d’octobre 1960, je fais état des exactions commises par mon pré-prédécesseur sur les conseillers municipaux (un tiers assassinés, un tiers mutilés) en proposant un retour à la démocratie . Je me cite : « brutalités et abus commis en 1959… interrogatoires accompagnés de sévices, disparition de quelques-uns et mutilation de quelques autres « . Curieusement, aucune réaction du colonel SAS de Tebessa à ce rapport qui me semblait potentiellement explosif.
Mais je préparais assurément la sanction que je méritai peu après pour un motif plus anodin « insolence envers un supérieur » : j’avais, scandalisant mon attaché civil, écrit au colonel qu’il avait agi » à la légère » en nommant, dans cette ambiance et à cette date, octobre 1960, une attachée féminine à cette SAS, censée promouvoir le féminisme -avant l’alphabétisation !- dans la bourgade, les mechtas et les douars environnants. Je fus condamné à quinze jours d’arrêts, que je devais théoriquement exécuter sous ma propre autorité. Après un jour de flemmardise, je décidai de ne pas arrêter mes activités de « pacification ». Mais sans céder aux injonctions d’un capitaine de cavalerie, mon voisin, qui m’ordonnait d’amener mon maghzen pour barouder aux côtés des cavaliers (mécanisés ! seules quelques SAS avaient des chevaux , comme à Guentis ) . Il avait raccroché en disant « mort aux cons ! », mais pas avant que je ne l’aie souhaité en bonne santé.
Je commençais à aspirer à « la quille ». On avait eu peur à El Ma : en venant tout d’abord, dans cette jeep bringuebalante, Jacqueline portant Dominique, le garde, le chauffeur et moi armés de nos P.M. ; puis lors des bombardements, avant d’apprendre qu’ils venaient de notre côté et visaient les incursions détectées sur la Ligne Challe, à quelques kilomètres de là.
Retour à Morsott après El Ma el Abiod : la fin à l’horizon
Au mess de Morsott, un lieutenant, après un discours de De Gaulle, avait dit : » Je prends mon P.M. et je vais descendre ce type-là » ; et une autre fois, j’ai été d’abord le seul à me lever pour la Marseillaise, suivi par les officiers du contingent et enfin, de mauvaise grâce, par les autres. A un officier du Cinquième bureau, qui nous incitait à critiquer -au moins – de Gaulle, j’ai eu l’ironique occasion de donner une leçon de discipline en lui disant qu’à l’Armée j’avais appris à obéir au chef, c’est à dire le Président de la République. Le lendemain, le colonel, par son officier de liaison, me donnait – discrètement !- raison.
Ces émissaires du 5ème bureau exhibaient dans les mess et chez les hommes de troupe des photos abominables de soldats assassinés, égorgés, émasculés, et souvent les parties sexuelles fourrées dans la bouche : appel à la vengeance, à la haine, à la violence, sans distinction, contre ces « sauvages » (au temps de la guerre du Rif on les appelait les « salopards », comme dans la chanson « Mon Légionnaire » !) , FLN patentés ou » bougnoules » ordinaires. Déjà la politique du pire que pratiquera bientôt l’OAS. Le SAS que j’étais ne pouvait que protester, mais mon capitaine ne fréquentait pas le mess des régiments postés à Morsott, me coupant la voie hiérarchique.
Autre anecdote, tragi-comique : un commandant (du 2éme bureau, renseignement, ou du 5éme, » action psychologique » ?) baladait triomphalement dans les mess d’officiers un chef FLN rallié, qui avait accepté la » paix des braves » proposée alors par l’armée française. Gros succès de ce combattant auprès de nos baroudeurs, qui saluaient le guerrier autant que le converti à notre cause. Après avoir visité du nord au sud tous les régiments occupant la frontière algéro-tunisienne, le converti devint renégat, et même relaps, rejoignant l’ALN et muni de précieux renseignements. Il y a eu aussi cette grosse opération (combien de » bananes » ?) montée sur les aveux arrachés à un suspect par la torture : sous la douleur il avait tout inventé, on l’a donc à nouveau torturé, logiquement, pour le punir de ses mensonges. Est-ce lors de cette opération que mon ami le sous-lieutenant An., polytechnicien, a oublié son PM sur le terrain ? d’où retour des hélicoptères sur le piton, colère du colonel ! L’X cohabitait avec un autre sous-lieutenant, un instit des plus sérieux, mais c’est celui-ci qui enverra une rafale de PM dans le ventre de l’écervelé en ayant un jour oublié de décharger son PM avant de le nettoyer. An. s’en tirera heureusement.
On était en automne 60. Quelques mois plus tard, grâce aux transistors, l’ensemble du contingent plus les régiments républicains allaient mettre aux arrêts les officiers » félons « . J’ai vaguement regretté de ne plus avoir été là pour observer la conduite de mon capitaine qui ne voyait depuis quelques années que » des progrès dans la pacification » de Morsott.
Deux autres souvenirs des régiments qui côtoyaient la SAS à Morsott : ce lieutenant alsacien qui, en tant que » malgré nous » avait gagné sa Croix de Fer sur le front russe, avant de déserter la Wehrmacht pour rejoindre les FFL et était resté dans l’Armée; mais il ne portait pas sa croix de Fer à côté de sa croix de Guerre. Et ce capitaine couvert de gloire et de décorations, qui, après s’être conduit comme un héros en Allemagne et en Indochine, s’était soudain écroulé, paniqué, lors d’un accrochage, sous les yeux plus désolés que méprisants des jeunes sous-lieutenants ses subordonnés …
Encore un regret : avoir refusé d’être fait » caporal d’honneur » de ce 26ème d’infanterie, comme me l’avait fait proposer le colonel K.. Il en a été fâché, m’a-t-on dit plus tard. J’étais beaucoup plus navré, mais je me sentais indigne d’un honneur que j’imaginais réservé à des héros : sans doute souvenir de la » charge héroïque » qui avait valu une citation à l’ordre de l’armée à mon grand-père, alors que je n’avais à faire valoir que des mérites pacifiques et administratifs, au mieux une chanceuse habileté sur le terrain. Ce régiment, » républicain « , ou simplement discipliné fut envoyé à Alger pour remplacer les troupes séditieuses de ce » quarteron de généraux en retraite « , que De Gaulle écrasait mieux de son mépris qu’en disant » à la retraite « , ceux qu’il fustigeait aussi en les rangeant sous les bannières de » la hargne, la rogne et la grogne »
Rennes, lundi [début décembre 60] Mon petit, à la fin de ma permission (23 jours pour le mariage de Gaby) je ramasse une gentille jaunisse que je prélasse depuis 3 jours à l’hôpital militaire de Rennes. Ensuite il y aura une convalo d’un mois, de sorte que me voilà en métropole jusqu’à la mi-janvier (Inch’Allah!) J’aimerais te lire et savoir quand tu auras la quille. Une lettre vue chez Ivernel me faisait peur. Je suis déjà tellement marqué par ce que je peux savoir, que je redoute les blessures que peuvent laisser les spectacles que l’on a pu voir. J’ai passé une permission à me démener pour dire un peu ce que je sais. Je m’y suis surmené dans un demi-nuage et le sentiment de n’être plus dans le même système de mesure. Je suis effrayé de ma violence et de mes intransigeances. Je ne peux plus voir les curés qui prennent leur parti de la misère et du malheur des pauvres. Peut-être l’hôpital va-t-il me ralentir et m’apaiser. Je suis heureux de ce nouveau délai qui m’est donné et qui n’est rien d’autre qu’une planque. Ne perds pas courage. Ne perds rien d’essentiel. J’ai envie de te revoir et besoin de te retrouver. Je pense à toi avec une amitié angoissée. Dieu te garde. Dieu vous garde. Valete et gaudete. Jean le Meur Service CX. Hôpital militaire A.PARÉ. Rennes. Ille et Vilaine (jusqu’ au 15 déc J’avais téléphoné chez toi fin octobre, tu étais reparti-
Alger, la peur dans la Kasbah
Avant de rembarquer pour la Métropole, quelques jours après Jacqueline et Dominique, j’ai passé quelques jours à Alger fin décembre 1960. Mon camarade J. Lethiec, SAS en poste à Alger, a tenu à nous faire visiter la Casbah, peu de temps après des manifestations qui l’avaient ensanglantée. Défi, provocation, dernier bizutage pour le « bleu » qui venait de vivre dix-huit mois dans son bled ? L. avait passé une nuit en prison pour n’avoir pas respecté le couvre-feu, et s’y était lié avec un responsable FLN. En sa compagnie, me dit-il, nous ne risquions rien. Mais j’étais le seul des cinq à n’avoir pas de vêtements civils. Par un aberrant point d’honneur je n’osai pas refuser et nous avons traversé la Casbah de bas en haut, beaucoup de regards, couvant la flamme, jetés sur mon uniforme et mon très voyant képi bleu. Heureusement, je ne portais pas d’arme : j’avais appris que ces « ennemis » avaient plus de respect pour un homme désarmé -et aucun intérêt à le tuer. Arrivé en haut, je soupirai de soulagement, mais L. et son garant FLN ont insisté pour refaire le chemin de haut en bas au lieu du détour par la ville « européenne ». En maudissant ma lâcheté, me reprochant de prendre des risques idiots alors que ma femme et ma fille m’attendaient en France – pardon, il fallait encore dire » en Métropole » -, très crispé, je les ai suivis. J’en ai gardé quelques cauchemars.
J. L. m’a fait aussi inviter à une » surprise-party » sur les hauteurs d’Alger. C’était un bel appartement, les filles étaient magnifiques, toute cette jeunesse – pieds-noirs et militaires d’Alger – éclatait de santé, de bonheur et d’insouciance. Le contraste avec notre vie dans le » bled » était insoutenable, angoissant : pourquoi avoir affronté le danger au milieu des Chaouias, avec ma femme et ma fille, si la vie heureuse s’était ainsi perpétuée sans nous ? Je sentais que je détonnais, que je gênais dans mon uniforme endossé faute de vêtements civils et mes presque trente ans, anachronique, traînant derrière moi un remugle de la » misère hautaine » des nobles et loqueteux chibani du reg, évitant avec soin la moindre allusion aux dangers, horreurs ou combats qui auraient pu me faire passer pour un faux héros vantard et mal élevé. L’Algérie que j’avais vécue avec ma femme et que je représentais malgré moi dans cette fête était l’envers obscène de leur Algérie insouciante et aveugle. Égoïsme d’enfants gâtés ? ou saine réaction d’une jeunesse qui refusait de se laisser contaminer par le désastre ?
Avant de quitter cette » France » d’outre-Méditerranée, en tant qu’appelé » libérable « , j’ai été convoqué par un des responsables des Affaires Algériennes, le colonel Dunoyer de Segonzac, cultivé, sympathique et un brin sceptique. Mon ami Lethiec, en poste auprès de lui après un séjour mouvementé dans une SAS, m’avait décrit comme un fantaisiste ; or je crois avoir pris ma mission très au sérieux, parfois au tragique, mais jamais à la blague, mon humour ne visant que ma propre personne. Le colonel m’a proposé la » valeur militaire « , me demandant si je pensais l’avoir méritée. J’ai dit que mes mérites guerriers ne me semblaient pas héroïques, ayant échappé, pendant ces dix-huit mois de bled et de » crapahutage dans les djebels » à tout accrochage sérieux, par chance autant que par prudence, content d’avoir épargné ma vie et celle de mes subordonnés. Cette » banane « , que j’ai vu attribuée à bien des officiers de bureaux , n’a pas été donnée au rigolo (ou subversif ?) qu’on voyait en moi ! Mais j’avais aussi été puni par le colonel de Tebessa de quinze jours d’arrêts de rigueur pour insolence, ou pour n’avoir pas voulu signer des factures douteuses …
Un rigolo : j’ai poussé M. de R. à justifier cette opinion en nous livrant, sur le bateau du retour, à une blague en échangeant nos képis : le sien tenait à peine en équilibre au sommet de mon crâne, le mien lui engloutissait les oreilles en lui arrivant au niveau des yeux. C’est à la Laurel et Hardy que nous avons ainsi salué les officiers supérieurs, mi-figue mi-raisin devant nos clowneries, dont nous partagions le mess. Mais si j’ai eu honte sur ce paquebot c’était, en sortant de nos cabines confortables, de voir sur le pont et au fond des cales, les jeunes soldats français faire le voyage de retour dans des conditions d’inconfort, de saleté et de puanteur indignes, l’odeur de vomi plus forte que l’humidité glaciale et poisseuse de sel marin dans le petit matin de fin décembre. Puis Notre Dame de la Garde est apparue, et nous sommes rentrés chez nous scrutant encore avec défiance, pendant des mois, les défilés propices à une embuscade dans les vallées paisibles de l’Ardèche ou de l’Isère.
Retour en Métropole : quels liens qui durent ?
Je retrouverai bien plus tard, à l’association des SAS, mon ami de Louis le Grand Jean Darras, mort en 2006. En 1952 nous étions chefs de classe lui des » Colos « , moi des » khagneux » et avions monté ensemble une grève des internes contre une mesure administrative injuste. Darras, père de deux enfants, aurait pu éviter d’aller en Algérie. Mais il m’a dit qu’il avait aimé cette mission de » chef » et de » guerrier » où il s’est illustré en obtenant le ralliement d’un chef de l’ALN, et aussi en défendant, avec la manière forte, la population à l’occasion d’un vol de matériel commis par le régiment voisin.
Envers le mokkadem et tous ces braves vieux soldats, avec leurs décorations prestigieuses, gagnées au sein de notre armée dans les campagnes d’Italie, d’Allemagne et d’Indochine, on peut avoir des remords. On leur disait : on ne vole pas un œuf, et ils obéissaient ; on leur disait : torture, égorge, et ils le faisaient. Mon rapport officiel sur les exactions d’El Ma el Abiod, ma plainte contre le capitaine de harka à Morsott n’ont nullement ému ma hiérarchie. Le jour de l’indépendance, comment la population, et les FLN venus parfois d’ailleurs, pouvaient-ils considérer les moghaznis qui avaient exécuté ces ordres … ? Et la politique de De Gaulle, sans doute assez machiavélique » dans l’intérêt de la France » a eu comme conséquence de livrer à la vengeance ces hommes désarmés par leurs officiers. Je me rappelle mon speech d’adieu » Il général Di Gaulle igoul koûl ma éna fil Djézaïr ou fil Francia : tous avec moi en Algérie et en France » … Combien cette petite lampe à huile romaine, cadeau du laconique mokkadem, m’est précieuse, et tragiquement émouvante, à moi qui ne me suis jamais considéré comme un « guerrier », et si peu un « chef » !
Mon collègue au lycée de Valence Michel Gilot, revenu d’Algérie avant que je parte pour l’armée, donc en 1957, nous avait confié l’image obsédante qui ne l’a sans doute jusqu’à sa mort jamais laissé en paix : cette file de villageois retournant vers leurs gourbis à cloche-pied, les soldats de sa compagnie – dont il était un sergent révolté mais impuissant, étouffé d’horreur mais paralysé – leur ayant brûlé sur ordre de leur officier la plante d’un pied en tant que suspects, pour » les faire parler » . Toute la population FSNA n’était-elle pas suspecte de sympathie envers les rebelles plutôt qu’envers l’armée française ?
Pouvoir aujourd’hui parler de cette guerre sans les réticences – mais la colère reste intacte – auxquelles la plupart des participants sont condamnés : c’est dû à la chance que j’ai eue à de nombreux égards : d’abord j’étais sensiblement plus vieux (27 ans) que les autres appelés (à partir de 19 ans), et plus averti par les polémiques au Quartier Latin, avec une culture qui m’avait donné « le goût des autres ». Autre chance : être tombé dans une SAS dirigée par un capitaine très soucieux de correction administrative, de rapports optimistes, et absolument pas porté sur le renseignement arraché par la force. Il y avait aussi, en 1959 plus peut-être qu’auparavant, la possibilité, à condition de s’y décider, de recourir à la fiction républicaine. Je ne me donne pas le beau rôle : j’ai eu cette chance presque imméritée de ne m’être pas sali les mains et je ne me donne pas les gants de condamner mes semblables qui n’ont pas » pu faire autrement « , jeunes hommes abandonnés au racisme ambiant, à la paranoïa des militaires, à l’égoïsme des profiteurs et à la lâcheté des politiques …
Moghaznis ou harkis : j’ai revu de ces hommes lors de cérémonies commémoratives, aux Invalides et à l’Arc de Triomphe. Au milieu d’eux, j’ai cru reconnaître leur odeur sèche de coureurs de djebels, la fragrance âpre et roborative du danger, celle des Aurès, effluves de graisse d’armes, de laine suintée et de cumin . Me trouvant à nouveau parmi ces combattants courageux jusqu’à la cruauté, je croyais reconnaître dans leurs corps épaissis, desséchés ou déformés par l’âge les maigres et infatigables arpenteurs d’erg et de reg, avec leurs mains noueuses, leur visage buriné aux yeux creux où passait comme un rêve d’orgueilleuse soumission féodale. Le chèche kaki, la djellabah ou en hiver la cachabia de laine râpeuse, le fusil et les cartouchières : et ils repartaient dans le petit matin en quête des fellaghas, parfois tout simplement les membres d’une autre tribu ennemie depuis des siècles, depuis qu’une chicaya les avait opposés pour toujours parce qu’un ancêtre avait détourné une nuit tel canal d’irrigation, avec ses mains ou d’un tranchant de houe. Ou bien à cause d’une préhistorique histoire de fille enlevée. Et ils s’étaient cherché d’autres allégeances, que cette guerre de décolonisation leur avait fournies : le FLN ou l’armée française, une armée que la famille de certains avait servie depuis deux ou trois générations, parfois plus, laissant des morts sur tous nos champs de bataille.
Des années plus tard, lors de l’affaire Érulin (dans les années 80), un colonel accusé d’avoir torturé en Algérie – avant qu’Aussaresses ne s’en vante, que Bigeard ne l’assume et que Massu ne l’admette en le regrettant – , et dont la mort était peut-être due en partie à ces accusations, j’ai évoqué dans la revue Esprit le cas de Jean Le Meur, dégradé (il me corrige: simplement révoqué!) et emprisonné pour s’être révolté contre la torture. Philippe Ivernel, notre camarade de la khagne de Louis Le Grand, Normalien, y avait fait paraître les lettres de Le Meur, dont à l’époque Françoise Giroud (l’Express), Morvan Lebesque (Le Canard enchaîné) et Pierre-Henri Simon avaient aussi parlé.
Un autre khagneux du même lycée, que je n’ai pas connu, Normalien, agrégé, aurait lui déserté; il serait devenu professeur en Tunisie puis en Algérie, enfin en France, amnistié. Mais cet engagement extrême n’était concevable ni pour moi ni pour Jean Le Meur.
Celui-ci a » simplement « , pendant la guerre d’Algérie, refusé de servir dans un régiment où l’on pratiquait la torture et les exécutions sommaires. Les cris l’empêchaient de dormir la nuit, et le jour. Professeur de lettres classiques, il était sorti sous-lieutenant des E.O.R. de Cherchell en 1960. Volontaire pour servir dans une SAS – selon la même démarche que moi -, il s’est vu imposer de faire d’abord une période dans un régiment. Chrétien comme son frère aumônier chez les « paras », breton et obstiné, il a refusé tous les compromis. Il a été jeté en prison dans ce cul-de-basse-fosse qu’était proprement sa cellule à Constantine, grandiose et lugubre ville coupée en deux par un ravin vertigineux, comme si le géant d’un conte arabe l’avait tranchée avec on ne sait quel cimeterre ou yatagan de la cime à l’abîme ! Sous-lieutenant S.A.S. , je suis allé le voir [ le 20 février 60, comme me le précise aujourd’hui Le Meur, qui a retrouvé la date dans son journal ] coiffé de mon ostensible képi bleu. Le commandant de la prison m’a fait part de l’estime dans laquelle il le tenait. Jean et moi nous nous sommes embrassés à travers les barreaux, deux gendarmes se sont précipités : ils avaient négligé de me retirer mon pistolet d’ordonnance. Jean a passé deux années en prison (le général Pâris de Bollardière n’a été puni, pour les mêmes raisons, que de deux mois de forteresse) , après lesquelles il aurait dû faire le reste de son temps de service s’il n’était pas tombé malade. Il a été réformé, et jamais réhabilité, alors qu’en l’an 2000 un général Aussaresses revendiquait l’usage de la torture et soulevait pendant quelques heures l’indignation des bonnes âmes. Cette visite à un subversif a sûrement été consignée dans mon dossier militaire.
Rentré en France, je continuai de militer, trop mollement sans doute, contre la guerre d’Algérie, fort cette fois, hélas, de mon expérience et des témoignages recueillis sur toute sorte d’atrocités imbéciles. J’acceptai d’être « boîte aux lettres » du comité Audin, présidé par Sartre et Beauvoir. Maurice Audin était un professeur communiste enlevé et torturé par des parachutistes qui l’ont fait disparaître. Pour exécuter les suspects, on avait trouvé l’euphémisme « envoyé à la corvée de bois », quand ce n’était pas « abattu pour délit de fuite ».
« Un de Gaulle ne pouvait pas mettre en prison un Voltaire », Sartre et Beauvoir, à la tête du comité Audin, étaient trop célèbres, mais la piétaille dont j’étais pouvait être punie plus discrètement : quand nous avons été nommés au lycée de Galatasaray à Istamboul, en juin 61, le ministre de l’Intérieur (Frey) et celui de la Défense Nationale (Messmer) ont fait annuler notre nomination. Je l’ai su par un ami de khagne, le normalien Gilbert Dagron. Il avait été comme moi officier des Affaires Algériennes dans une SAS (Section Administrative Spécialisée) en Algérie, et avait obtenu un poste aux Affaires Étrangères, où mon dossier de détachement à l’Étranger était passé entre ses mains. Grâce à son appui et celui de Stephane Hessel (un parfait inconnu pour moi, à l’époque, mais qui avait dû reconnaître un « indigné » ! ) , alors au ministère de la coopération, nous avons, par un stratagème administratif, échappé à la vindicte de l’Intérieur.
Dans ces conditions il nous a fallu partir précipitamment, non pour la Turquie où nous avions été nommés, mais pour le Mexique où le proviseur du Lycée franco-mexicain réclamait d’urgence un professeur et une institutrice. C’est ainsi que j’ai découvert l’Amérique latine et que j’en ai traduit quelques auteurs, avant tout l’Argentin Ernesto Sabato, romancier « engagé » . J’ai eu l’opportunité de le soutenir dans son combat contre la dictature militaire ; on retrouvait alors en Argentine, au service de celle-là, des « conseillers en torture » comme Aussaresses et autres OAS dont je croyais avoir définitivement perdu la trace en Algérie : la boucle était bouclée.
Extraordinaire « illusion lyrique » des anciens SAS de l’AAAA (Association des Anciens des Affaires Algériennes) , dont les souvenirs de nos contacts avec la population » pacifiée » sont idylliques. Un historien, qui a tenté en vain de faire passer à la télévision une vidéo sur nos témoignages de la guerre d’Algérie vécue dans les SAS, m’a dit que j’étais le seul à lui en avoir rapporté des éléments critiques. Les responsables des chaînes n’ont pas dû trouver crédibles les témoignages angéliques de mes camarades que la nostalgie – mais je n’exclus pas les remords -, a amenés à idéaliser leur expérience algérienne : dans une AG, sans rire – mais en évitant de se regarder, tels les aruspices romains ! -, tous protestaient qu’ils n’avaient jamais constaté de tortures , » dans leur coin du moins « .
Après La Bataille d’Alger , Le Vent des Aurès , Avoir vingt ans dans les Aurès , le film qui nous a semblé la meilleure illustration de notre expérience vécue – en très condensé heureusement -, et le plus juste sur ce qu’a pu être cette guerre innommable, et longtemps innommée, est l’Ennemi intime . Jacqueline et moi sommes sortis en larmes de sa projection (en 2009 ?) : je me rappelais le petit berger abattu d’une rafale hasardeuse et le regard brûlant de l’adolescent soutenant son vieux père ensanglanté.
Cette carte nous est parvenue en septembre 61 au lycée franco-mexicain, Homero 1522, Mexico Distrito Federal :
TRESSIGNAUX le 9 août 61. Tout d’un coup le désir de savoir où tu es et ce que vous devenez, et envie de te revoir. Pour moi, après de longues jaunisses, le 6°R du Génie à Angers, où la quille m’attend le 1° sept. Les tranquilles garnisons de métropole. Une bonne nouvelle, une surprise : mon casier judiciaire est vierge comme celui de beaucoup d’honnêtes gens. Donc réintégration probable sans histoires. Où ? Beaucoup de tentations, le monde entier, mais un désir assez constant, l’Afrique du Nord, en attendant l’Algérie. Ivernel papa de M., Vitoux se marie. M.Philip va aux Amériques (Yale). Le monde se repeuple après un long déluge (?) Salut et amitié
[Jean Le Meur, signé en arabe]
Quévert, 21 août -13 septembre 2013
Mon cher Michel, je t’écris à la diable et un peu au petit bonheur la chance […] je mesure, je commence à mesurer avec une lucidité tardive tout ce que j’ai laissé filer et tomber et sombrer […] En un sens, je serais tenté de dire que j’avais déjà trouvé, faut-il dire cherché, derrière les gros murs de la prison, un asile protecteur où l’inaction avait de longs jours devant elle. Mais là je force peut-être la note.
En tout cas le choix qui a été le tien, et qu’en un sens j’avais esquissé ou entrevu, t’a permis de rester au plus près de la réalité, dans sa dimension complexe et dramatique, on peut dire tragique à laquelle j’ai échappé comme aux malaises des hésitations et des ambiguïtés […] qui étaient et qui sont une des dimensions fondamentales du politique, c’est à dire du vivant et du concret, autrement dit de la présence au monde (tout va bien, me voilà revenu au temps des disserts de philo) […] Ce dont je suis sûr et plus sûr que jamais c’est que cette guerre, c’est à dire ces massacres et ces malheurs ont aggravé l’injustice de la colonisation […]Et nous leur apportions le bienfait et les lumières de la civilisation, dont nous sommes, c’est bien connu de tous les historiens, les pionniers et les champions. La Révolution française, c’est bien en France qu’elle a vu le jour, la France qui est aussi, mais ça tu le sais moins bien que moi en quasi mécréant que tu es, la France c’est de toute éternité la fille aînée de l’Ėglise […]
Une petite chose me concernant -je n’ai pas été dégradé mais, je crois, simplement révoqué ce qui, pour les militaires, est moins infamant […]
Reste mon effarement, et mes interrogations. Y a-t-il à ce sujet des recherches un peu éclairées. Ma question: comment les élites intellectuelles de l’Université française ont-elles vécu ce moment majeur et accablant de l’histoire française, je pense en particulier à Normale Sup – je pense aussi sur un autre plan, aux curés. Et nous étions au sortir de l’Occupation allemande, ou nazie, qui je crois a duré moins d’un siècle […]
Je boucle et bâcle cette bafouille que tu utiliseras, comme aussi les lettres d’antan comme bon te semblera […] J’aime ton texte, qui dit beaucoup de choses, et en suggère tant d’autres. Bien sûr je regrette que par pudeur, et modestie, tu aies été plus allusif que … (ici je cale) [15 jours plus tard: explicite ou discursif (ça valait la peine de chercher)], que tu aies préféré la litote aux développements de l’éloquence. Je pense que tu aurais plus à dire, en montrant davantage le quotidien de cette longue expérience, les émotions et les colères, et les rages. j’aimerais de même écouter Jacqueline, l’entendre raconter […] Quant à moi […], je regrette de n’avoir pas fait parler davantage mes copains et amis algériens de Constantine, et de n’avoir pas maintenu et enrichi par la suite la fraternité que j’ai connue avec eux.
Dieu vous garde Kenavo Jean Le Meur
J’ai retrouvé le passage […] qui est la dédicace dans le livre, en tête de l’album [L’Algérie en couleurs, de Tramor et Slimane Zeghidour] . La voici: « A mes frères Derradji et Khelifa, à ma sœur Houria, tous trois nés et morts dans le camp de regroupement d’Erraguène » . C’est situé, sans plus de précision dans « le massif des Babors »[…] Le livre n’a rien d’une révélation il est pour moi une revisitation et une redécouverte de ce que l’oubli ou la négligence laissent dans l’ombre |[…]
Michel Bibard Mexique 1961 -Paris 2013
Plusieurs semestres après la diffusion du texte de Michel Bibard, celui-ci retrouve dans ses archives deux compléments qui valent eux-aussi d’être publiés. D’abord un témoignage sur l’été 1962 vu depuis Morsott.
Mokrani, SNCFA, Morsott, Bône Morsott, le 15 – 6 – 62
Cher Monsieur Bibard
Votre aimable lettre datée du Mexique m’est bien parvenue, ainsi que celle expédiée de France après votre départ de Morsott. Je vous remercie infiniment de vos souhaits et félicitations exprimés à l’occasion de notre indépendance, auxquels [je] suis bien sensible. Soyez assuré Monsieur Bibard de nos sentiments sincères de gratitude envers tous ceux qui ont sympathisés avec nos aspirations qui honorent les patriotes des deux bords de la Méditerranée. Vous avez laissé des amis ici, bien que sous l’uniforme (c’est ce qui augmente votre mérite) qui seront enchantés de vous revoir chez eux.

l’écriture à la plume: avec une maîtrise parfaite du français écrit…
Oui, Monsieur Bibard, on s’est bien compris sur les problèmes graves dévolus à l’Algérie de demain, fort heureusement le bon sens et la raison ont prévalues dans la négociation d’Evian comportant l’essentiel qui est « coopération avec la France », ce qui est réjouissant pour l’avenir de notre pays. En effet, il y aura beaucoup à faire pour déblayer le terrain en préjugés raciaux, cautériser les blessures, partir de l’avant dans le sens du progrès et de la démocratie.
Avec la France bien des obstacles seront aplanis, l’amitié franco-algérienne y gagnera pour laisser place à la Fraternité. Les chefs de notre révolution sauront, je le souhaite, mener la barque à bon port.
Je n’avais pu répondre à votre première lettre, entre temps je fus muté à Philippeville où j’avais égaré votre adresse de France, Hamid également, c’est lui qui m’avait fait voir la photo de votre belle et gracieuse fille Jacqueline. Les élèves de votre dame vous conservent leur gratitude et leur respect, les petits de Hakimi et Mekhalia, ce dernier est avec Hamid au lycée de Bône. Ils travaillent bien, mais Hamid doublera sa 6e en octobre prochain. Mabrouk passera en CM2.
Pour les nouvelles de Morsott, les réfugiés de Tunisie réintègrent leurs demeures (plus-tôt ce qui en reste), la propagande pour le oui se fait mollement, car le FLN compte sur le 100% des voix. Les notables d’ici sont soumis à des travaux d’organisation, les patriotes de la dernière heure font plus de zèle pour se faire pardonner leur molesse passée. Les jeunes sont groupés comme boy-scouts musulmans, le syndicat de chaque corporation est mis sur pieds (commerçants, ouvriers agricoles, mineurs, fonctionnaires, etc…) Le Croissant Rouge s’occupe beaucoup, l’organisation sportive et féminine de même sous les directives des chefs FLN, ça marche pour ne pas dire à la baguette. Des enfants de 10 à 18 ans font journellement des exercices d’ordre serré, on leur apprend des chansons patriotiques en vue du défilé pour le jour de l’indépendance. C’est l’euphorie en somme.
Après le referendum l’on verra. Il y aura du boulot pour tous, paraît-il. Pour le moment, la contribution pécuniaire, volontaire, donne beaucoup de résultats. Enfin, Monsieur Bibard, voilà brièvement exposé ce qu’à mes yeux j’ai crû devoir vous signaler. La récolte est mauvaise, il y a de l’herbe, les bêtes sont grasses, la viande à 1000 AF le kilo.
Espérons que l’OAS d’Oran et de Bône rentre au bercail, ils ont fait que trop de mal.
Avec mes cordialités bien sincères, croyez Monsieur à mes chaleureuses salutations fraternelles et mes respects à Madame, beaucoup de bonnes choses à Mademoiselle, Bien à vous tous
Mokrani [chef de gare de Morsott]
Autre texte : le rapport mensuel de Bibard, l’officier de SAS de El Ma El Biod, au colonel de Tebessa pour le mois d’octobre 1960, double conservé par l’auteur
Département de Bône, arrondissement de Tebessa, SAS de El Ma El Abiod
Nom de l’officier : S/Lieutenant Bibard, N° de téléphone, néant
Rapport du mois de : octobre 1960. Etat d’esprit de la population
L’action du précédent chef de SAS a peu à peu redressé une situation quasi désespérée, conséquence des brutalités et des abus commis en 1959, dans lesquels les dirigeants de la SAS s’étaient gravement compromis aux yeux de la population. Cette population a retrouvé le chemin de la SAS. Elle reste cependant très méfiante, réfugiée dans une attitude d’irresponsabilité voulue, qui risque de grever lourdement les prochaines élections municipales. Témoin cet habitant de l’Adila : « La liste qui sera faite par les français sera la bonne ». Le problème de découvrir le fond de leur pensée reste entier.
Aigreur et lutte d’influence caractérisent les rapports Secrétariat de mairie – SAS – Municipalité. Chacune de ces parties tenant l’autre pour responsable du malaise qui a abouti à l’arrestation du Conseil municipal, aux interrogations accompagnées de sévices, à la disparition de quelques uns et à la mutilation de quelques autres, il s’ensuit une paralysie très regrettable du fonctionnement administratif. D’où un nombre trop important d’affaires en instance.
La solution préconisée par mon prédécesseur, le départ du secrétaire général intercommunal et l’élection d’un nouveau conseil municipal, devra, pour être efficace, s’accompagner d’une remise en ordre complète de ce fonctionnement administratif. Il sera souhaitable que la mairie traite les affaires de son ressort et que la SAS soit au moins tenue au courant de la vie municipale.
Les mesures que le Chef de SAS n’a pu obtenir de voir prendre seront facilitées par le départ spontané du Secrétaire général intercommunal en décembre. Il serait donc bon de prévoir le recrutement d’un nouveau secrétaire et d’activer dans le même temps l’élection du conseil municipal.
On peut alors espérer que la population et ses représentants prendront conscience de leur responsabilité, dans un climat de confiance réciproque et de démocratie scrupuleusement rétablie. [Ce rapport n’a pas reçu de réponses des autorités supérieures, soit le colonel SAS et le sous-préfet de Tebessa]
Suite du roman de Bibard:
Michel Bibard, depuis la publication de son article (2013) a continué à explorer ses archives. Il nous donne en 2018 des documents précieux qui illustrent la guerre. Propagande contre propagande. Du côté de l’Armée de libération nationale, il faut se montrer comme une armée moderne et légitime dans un conflit international injuste : en s’adressant aux militaires professionnels de la Légion étrangère. Le tract présente sur une face trois soldats allemands, nés en 1934 et 1936, ayant déserté en 1958.

L’autre face nous donne deux portraits de déserteurs, sourire aux lèvres, dans un cadre « oriental ». Le texte d’accompagnement :
L’ALN est une armée qui se bat pour une cause noble et juste, une cause que vous avez vous-mêmes ou que vos pères ont défendue dans chacun de vos pays, celle de la liberté. C’est pourquoi l’ALN fait appel à votre sens de l’honneur, à votre sens de la justice pour comprendre la grandeur du combat du Peuple Algérien.
(IMAGE)
Heureux de se trouver dans les locaux du FLN pour remplir les formalités de rapatriement
Légionnaires !
Abandonnez une armée où votre dignité est bafouée, quittez les rangs d’une légion où vous n’êtes pas des soldats, mais des mercenaires utilisés dans des besognes honteuses et injustes, franchissez les lignes françaises pour retrouver la liberté. L’ALN vous accueillera et prend l’engagement d’honneur de vous faire rapatrier dans vos familles.
LAISSEZ-PASSER
Combattants algériens !
Vous êtes tenus de faciliter le passage et la circulation de tout légionnaire ou soldat français qui quitterait les rangs de l’armée française pour rejoindre ceux de l’Armée de Libération Nationale
Le Commandement de l’ALN
Conservez ce tract, il vous servira de LAISSEZ-PASSER

Deux ans plus tard, milieu 1960, Michel Bibart prend en notes manuscrites le contenu d’un tract de l’armée française incitant les « combattants du Djebel » à déserter pour accepter la « paix des braves » proclamée par De Gaulle.
Il conserve un texte « ronéoté » reçu à la SAS d’El Ma El Abiod en novembre 1960 (pour être réutilisé auprès de la population), à un moment où tout se joue déjà sur le plan diplomatique, où l’ALN est à bout de souffle à l’intérieur de l’Algérie :
HARANGUE AUX VILLAGEOIS
A L’OCCASION DES POURPARLERS DE MELUN
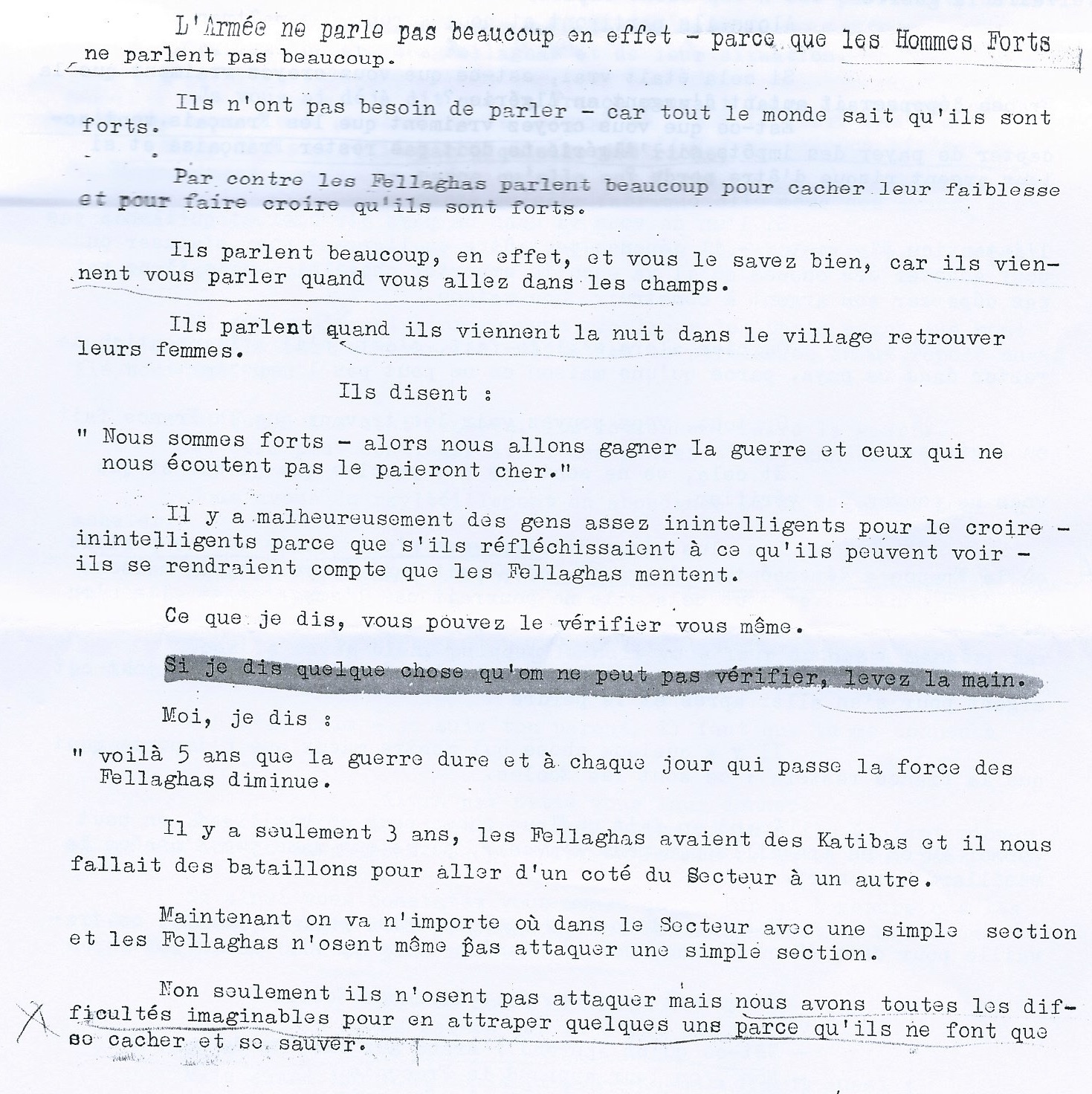
(extraits du tract…) Lorsque je vous ai parlé, il y a quelque temps, je vous ai dit ceci- rappelez-vous : Les fellaghas disent : « Dans quelques temps les français seront fatigués de faire la guerre ». Alors ils partiront et nous serons les maîtres. Si cela était vrai, est-ce que vous croyez vraiment que la France dépenserait autant d’argent en Algérie ? Est-ce que vous croyez vraiment que les Français vont accepter de payer des impôts si l’Algérie ne doit pas rester française et si leur argent risque d’être perdu ?
Si l’un de vous va dans un pays étranger et qu’il n’a pas l’intention d’y rester, il dépense peut-être de l’argent pour s’amuser ou pour acheter des choses qu’il va ensuite emporter chez lui, mais il ne va pas dépenser son argent à construire une maison. Ou bien alors, s’il le fait, c’est qu’il a l’intention de rester dans ce pays, parce qu’une maison on ne peut pas l’emporter. Or tous vous pouvez voir les travaux que la France fait en Algérie. Et cela, ce ne sont pas des paroles que je dis et que vous ne pouvez pas vérifier. Les plus vieux d’entre vous n’ont jamais vu une période où la France a dépensé autant d’argent, construit tant de routes, de maisons, d’écoles, etc. […] Il y a quelque chose qui montre mieux que n’importe quoi que la France restera : ce sont les Ecoles […] Et qu’est-ce qu’on fait dans ces écoles ? Est-ce qu’on apprend l’Arabe aux enfants du pays ? – Non, on leur apprend le Français – A lire, écrire, parler le Français- Pour que dans 20 ans ils soient complètement des Français, comme les Français de Métropole. – Et ces écoles, on en construit partout, partout, jamais on n’a construit autant d’écoles […] Est-ce que cela signifie que la France va quitter l’Algérie ? – Si quelqu’un le pense, qu’il le dise. Si je dis quelque chose qui n’est pas exact, dites-le.
Parlons encore des Fellagahs et de leur situation. Je vous ai déjà dit que la France pouvait faire la guerre indéfiniment […] Mais les fellagahs, eux, crèvent de faim, et ils sont obligés de ménager leurs munitions. Vous le savez bien, puisque la nuit vous leurs donnez à manger, par pitié parce qu’ils vous disent « j’ai faim, je suis ton parent » […] Ils disent aussi « nous avons en Tunisie une Armée et un gouvernement » […] Malheureusement pour eux il y a aussi le barrage avec l’électricité […] C’est vrai ou ce n’est pas vrai ? C’est vrai il y a en Egypte, en Tunisie des hommes qui disent qu’ils sont le gouvernement Fellagah. Et même ils ont de l’argent. Ca c’est vrai. Ils sont même riches […] c’est votre argent qu’ils ont pris.[…]
Pour le chef du gouvernement [français], tous les Français, qu’ils soient chrétiens ou musulmans, sont ses enfants, même ceux qui font le mal. Ceux-là, il les punit parce que son devoir est de protéger sa famille, mais il serait content de leur pardonner. C’est pourquoi le Général de Gaulle a offert en 1959 aux Fellagahs la « PAIX DES BRAVES » […] Donc les Chefs Fellagahs sont allés à PARIS. Que va-t-il se passer ? Eh bien, s’ils demandent pardon, s’ils demandent à nouveau à entrer dans la famille française, certainement on va leur pardonner. Naturellement ils devront abandonner leurs armes. Naturellement, dans les villages, ceux qui auront toujours été fidèles à la France passeront avant eux. […] Ici, dans le secteur, parmi les harkis, il y a d’anciens Fellagahs. Ils se sont repentis, ils ont donné la preuve que, désormais, on pouvait avoir confiance en eux. […] Vous pouvez obliger [les Fellagahs] à demander la paix, rapidement, en refusant de leur donner de la nourriture, en refusant de les laisser renter, la nuit, dans les villages voir leurs femmes. Quand ils seront chassés dans les montagnes, comme des bêtes […] il y aura la paix […]
Je vous ai parlé longtemps, avec mon cœur, avec ma raison, si j’ai dit des choses qui sont fausses ou qui ne sont pas bien claires, Dites-le moi
[1] Pour la première fois depuis les 18 mois d’existence de ce blog, un ami accepte d’y participer par le présent récit de souvenirs. Je connaissais déjà le brouillon de son texte, qu’on peut consulter sous sa forme orale http://www.youtube.com/watch?v=80_vrxra4gw
Mon texte le plus récemment posté « Les SAS dans la guerre d’Algérie » http://alger-mexico-tunis.fr/?p=780 est en somme l’introduction d’un géographe aux souvenirs d’un homme de littérature ; en espérant qu’après Michel Bibard, d’autres me confient leurs réflexions et leurs souvenirs. Claude Bataillon
Sur les harkis, un site bien fait à consulter: http://odysseo.generiques.org/resource/a011442499649udtyyE
[2] « Français de souche européenne »





![Devant le mess à Morsott, Michel Bibard en civil, 1960 [photo Michel Bourguignon]](http://alger-mexico-tunis.fr/wp-content/uploads/2013/12/IMG_3245.jpg)




